Septentrion. Jaargang 6
(1977)– [tijdschrift] Septentrion–
[pagina 73]
| |
Francis Poulenc et son héritage musical aux Pays-BasFrank Onnen Né à Baarn (Pays-Bas) en 1915. Etudes au conservatoire d'Amsterdam et au conservatoire national de Paris. Correspondant à Paris pour la radio, la télévision et pour plusieurs journaux et publications du Benelux. A notamment publié: Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Strawinsky, Excursies door de Franse muziek, Encyclopédie de la musique. Mettons nous, pour commencer, d'abord d'accord sur le sens exact qu'il faudrait attribuer au titre de cet articleGa naar eind(1): L'héritage musical du compositeur français Francis Poulenc aux Pays-Bas. Les rapports entre le musicien et les Pays-Bas ont été, depuis nombre d'années, pendant sa vie mais aussi après sa mort en 1963, en effet suivis et particulièrement intenses. En tant qu'accompagnateur, et le mot est faible, disons donc plutôt, en tant que frère jumeau musical du grand chanteur Pierre Bernac, Francis Poulenc s'est produit dans d'innombrables récitals dans tous les centres musicaux de ce pays, et ce fut encore à Maastricht, dans le Sud de la Hollande, qu'il a donné avec l'Orchestre de Limbourg sous la direction de son chef André Rieu, quelques jours avant sa mort, son tout dernier concert, et interprétant son célèbre Concert champêtre, sur lequel je reviendrai encore plus tard. Sa disparition, le 30 janvier 1963, je peux dire sans forcer mes mots, qu'elle frappa douloureusement les mélomanes hollandais, et tous les grands journaux lui consacrèrent des articles nécrologiques en insistant sur la place importante que Poulenc n'avait cessé d'occuper dans la vie musicale du pays. Dix années après, la revue musicale Mens en Melodie y revint pour célébrer cet anniversaire de sa mort. Et ce fut en particulier le fondateur et chef de la chorale professionnelle Het Nederlands Kamerkoor, Felix de Nobel, qui rappela, une fois de plus, les liens qui avaient existé, entre lui et le compositeur, ayant écrit plusieurs oeuvres pour cette formation, dont les Quatre motets pour le temps de Noël. Ayant appris qu'il venait de les enregistrer, Felix de Nobel se souvint que Poulenc le poursuivit avec des petites missives pleines d'impatience, pour en écouter au plus tôt le résultat. Il publia un de ces envois, assez caractéristiques pour l'esprit espiègle du musicien, | |
[pagina 74]
| |

Francis Pouleux et Denise Duval.
et c'était une lettre composée de deux petites feuilles. Sur l'une, il lui répéta une fois de plus qu'il ne pouvait vraiment plus attendre, pour lui demander de transmettre l'autre feuille au Père Noël. Et à ce bienfaiteur, dont on s'apprêta justement à célébrer la fête de sa naissance, il s'adressa dans les termes suivants et écrits avec des bâtons longs, raides et enfantins: Chère Paire Noël, Et qu'il n'ait certainement pas été déçu de ce cadeau qu'il finissait bien de recevoir enfin, voilà ce dont on peut bien s'assurer encore aujourd'hui en écoutant à notre tour ce très beau disque. Je peux donc affirmer que Francis Poulenc a été pour la Hollande probablement le compositeur français et contemporain le plus connu, sinon le plus apprécié de tous, et leurs excellents rapports réciproques ne se sont jamais démentis. Mais cela dit, je veux quand-même souligner qu'en parlant d'héritage musical, il ne s'est jamais agi entre eux pour antant d'une quelconque école, car Poulenc n'avait décidémment rien d'un chef d'école et dans ce sens également, il était très proche de Claude Debussy - dont il fut, pour la mélodie, certainement l'héritier direct - qui, lui, détestait copieusement ces épigones qu'on appelait alors ‘les debussystes’ et dont il disait une fois qu'il craignait qu'un jour ils ne le tuent. Il n'y avait donc, dans ces relations entre Poulenc et certains compositeurs hollandais, rien d'organisé ni même de délibérément voulu, et cette remarque ne concerne du reste pas seulement les Pays-Bas, car en France non plus, ce compositeur n'a pas eu ou laissé, au sens propre du terme, des disciples ou des élèves. Autodidacte lui-même, Poulenc n'a en effet jamais enseigné.
Quand je parle donc, à défaut d'un mot plus approprié, d'héritage musical, je pense par conséquent à autre chose.
Chaque grand artiste et, a fortiori, chaque grand créateur est, par la force des choses, une sorte d'émetteur diffusant un courant atmosphérique ou certains phares ou signaux plus ou moins déchiffrables ou captables et que l'on appelle plus communément ‘des influences’. Pour les musiciens hollandais, Poulenc ne fut pas seulement un grand compositeur, et tout à l'heure je voudrais bien essayer de le cerner et le définir d'une manière un peu plus précise, mais encore et surtout un grand compositeur typiquement français. Et à l'exemple de Debussy encore, Francis Poulenc, pour signer ses oeuvres, aurait pu également accoler à son nom ces deux mots si évocateurs dans leur simplicité de ‘musicien français’. Et voilà un autre mot de lâché, celui de ‘simplicité’. On s'en est servi souvent pour caractériser aussi bien la musique que la personne de Francis Poulenc, mais attention! Car cette fameuse simplicité est loin d'être simple. Elle fut, en vérité, le fruit d'un processus d'une extrême complicité, et on se tromperait donc lourdement en supposant que ses compositions lui coulèrent sans peine et abondamment de sa plume. Et si l'on a signalé dans son inspiration et dans le choix de quelques-uns de ses sujets une certaine concordance d'âme | |
[pagina 75]
| |

Francis Poulenc et Roland-Manuel à Aix-en-Provence.
entre Poulenc et Schubert en tant que mélodistes, sur le plan de la facilité technique, ils n'avaient en vérité que peu de choses en commun. C'est que la personalité de Poulenc lui-même était constitué d'éléments ou de composantes souvent assez disparates pour ne pas dire contradictoires et dont il faudrait donc maintenant s'efforcer d'en faire un certain inventaire.
Le critique musical Claude Rostand, qui connaissait admirablement bien et depuis sa prime jeunesse Poulenc - qu'il a, du reste, suivi, quelque temps après lui, dans la tombe -, a trouvé un jour une formule heureuse sous forme d'antithèse en constatant que son ami fut moitié voyou et, pour l'autre moitié, moine. Et si Poulenc lui-même estimait ce slogan quand même un peu fort de café - et peut-être faudrait-II en effet, à son égard, mieux parler, au lieu de voyou, de gavroche, ce même gavroche que symbolise ou incarne, selon monsieur Valéry Giscard d'Estaing lui-même, ensemble avec Marianne, le peuple français -, cela n'a pas empêché que cette trouvaille a cependant beaucoup servi. Et servons-nous-en donc une fois de plus. Cet aspect du moine touchait évidemment à sa musique religieuse, ainsi qu'à son opéra le plus célèbre, le Dialogue des Carmélites, pour se manifester qu'assez tard dans sa vie, lorsque Poulenc allait déjà vers la quarantaine. Généralement, on lie ou attribue ce domaine religieux de sa production indirectement à la personne de son père, homme d'affaires en effet très croyant, mais qui mourut déjà en 1917, quand le fils n'avait que dix-huit ans. Sa mère, Parisienne de naissance et, en plus, fort bonne pianiste, qui hissa son fils à l'âge de cinq ans déjà sur le tabouret de piano, et - comme elle fut bien inspirée! - cette mère, agnostique, négligea par ce fait cette éducation religieuse après la mort du père. Et ce ne fut que vers l'année 1935 que ce sentiment spirituel se révéla de nouveau pour ne plus jamais le quitter et donner naissance à une longue série d'oeuvres dont les motets déjà cités, les très émouvantes Litanies à la Vierge noire, la Messe ou le Stabat mater avec lesquelles Poulenc a indubitablement renouvelé la musique liturgique de notre temps. Un renouvellement qu'il faut considérer, me semble-t-il, d'une part comme une libération de tout un tintamarre de formules et de clichés issu d'une tradition routinière d'angélisme professionnel à la Saint-Sulpice et hérité du dixneuvième siècle et, d'autre part, comme une remise en valeur de cet épicurisme latin, sinon rabelaisien et qu'un François Couperin incarnait aux dix-septième siècle. Ce même Couperin, qui n'avait décidémment jamais ressenti le moindre besoin de se défaire de sa galanterie en jouant sa propre musique dans l'église du Saint-Gervais, dont il fut, comme on sait, l'organiste attitré. Je me vois néanmoins obligé de laisser maintenant à mon regret et malgré son extrême importance, ce pôle religieux de son oeuvre de côté, car il ne touche que très indirectement le sujet que je me proposais de traiter ici. Ce n'est en effet pas, ou à peine, cette partie religieuse de sa production qui a constitué l'essentiel de son héritage musical en Hollande.
Et voilà donc pour le moine et parlons | |
[pagina 76]
| |
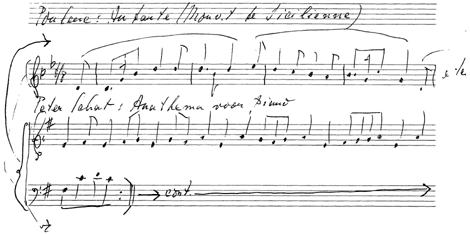 maintenant du gavroche - ou du voyou - et sans oublier, bien entendu, qu'il en reste encore tout un monde d'autres éléments caractéristiques pour sa personne et sa musique entre ces deux personnages. En effet, ce franc parler, cette désinvolture, cette verve, cette gouaille, cette malice, tout cela appartient bien en propre au gavrouche, dont Poulenc possédait en maître le vocabulaire, un peu, mais à vrai dire un tout petit peu, comme Louis-Ferdinand Céline introduisait en premier le langage parlé et fleuri de l'argot dans la grande littérature française moderne, qu'il a, par ce fait, révolutionné, dynamitisé. Poulenc, lui, de son côté, n'avait en effet, que peu de traits en commun avec ces dynamiteros ou guerrillos qui se battaient sur les barricades ou dans les tranchées de la révolution. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il ne fut qu'un rétro et totalement sourd aux bruits et éclats de ces mêmes combats. Mais il y en a dans sa mysique aussi, et peut-être autant de pudeur, surtout dans sa musique religieuse et l'impertinence - est-il nécessaire de le dire? - n'a évidemment rien à voir avec la vulgarité. Il y a ensuite de la tendresse, de la clarté et il y en a de l'esprit à revendre. Il y a autant de sensibilité et il y en a aussi, et notamment dans sa musique de piano, ce côté souvent un tantinet facile, sinon presque salonard. Il y a, et je l'ai déjà signalé, cette galanterie joyeuse qui le relie au siècle des Couperin, Rameau et autres clavecinistes. Il y a le cirque et le musichall, mais aussi le grand opéra, de sorte que Maurice Chevalier, qu'il vénérait, put voisiner dans son oeuvre tout naturellement avec l'écrivain mystique Georges Bernanos. Il y a le surréalisme d'Appolinaire dans l'opéra bouffe les Mamelles de Tirésias, et il y a la grâce peut-être quelquefois un peu sentimentale de Louise de Vilmorin dans les Trois Poèmes. On pourrait allonger, bien sûr, cette énumération encore bien plus loin pour en conclure, un peu comme dans la célèbre chanson de ce même Maurice Chevalier, que tout cela, ça fait un excellent Français, et compositeur de surcroît. Mais évidemment, cela n'expliquerait en même temps rien ou peu de ce mystère qui s'appelle Francis Poulenc et dont la musique | |
[pagina 77]
| |
ne ressemblait qu'à lui, pour se faire reconnaître immédiatement à la première note, et je dirais presque par son parfum. Et ce mystère-là restera donc entier et cela est certainement bien mieux ainsi. Parce qu'il ne faut pas essayer de démonter une telle horlogerie, au risque de la détruire.
Pour le besoin de la cause, sinon de ma démonstration, je voudrais retenir maintenant surtout deux composantes de base ou de directions principales parmi tous ces ingrédients. D'abord, le néo-classicisme de certaines de ces oeuvres comme le Concert champêtre, et après, ce côté disons folklorique, cette substance argotique, et dont on retrouve les traces dans ses ballets les Biches et surtout les Animaux modèles, dans l'opéra les Mamelles de Tirésias ou dans son Concerto de piano.
Après avoir tenté ainsi de brosser en quelques traits son portrait, il faut maintenant s'efforcer de situer Francis Poulenc, comme on dit un peu pompeusement, dans le cadre ou le paysage de notre temps.
On a souvent parlé de ce phénomène bien connu qu'un compositeur, ou un artiste en général, soit obligé, après sa mort, de passer par une période plus ou moins prolongée, pendant laquelle ses contemporains cherchent à déterminer sa place exacte dans le monde ou l'histoire pour essayer de distinguer et de séparer le blé de l'essentiel de l'ivraie de l'accessoire: à savoir les résidus de certaines modes ou courants temporaires ou dépassés. Cette filtration par le temps, qu'on a aussi appelé, ‘le passage au purgatoire’, Poulenc l'a connu, je crois, également et dans un passé récent on a donc quelque peu négligé sa musique. Mais il me semble qu'il sorte aujourd'hui de ce purgatoire et qu'on est peut-être même en train de le redécouvrir de nos jours. C'est ainsi que son opéra Dialogue des Carmélites vient d'être monté de nouveau aussi en France - aux Etats-Unis, il n'avait jamais quitté le répertoire - et que ses mélodies et pièces de piano, elles aussi, réapparaissent de nouveau de plus en plus sur les programmes de nos concerts.
Cette rentrée ou réapparition de Poulenc coïncide, pour s'expliquer en même temps, avec une évidente réaction contre les excès d'une certaine domination, sinon d'une domination certaine, de l'intellect, du cérébralisme et souvent même du mathématisme, et qui a été le fait du courant dodécaphoniste ou sériel qui découlait de l'école de Vienne de Schoenberg et de Webern. Ecole qui fut, après la dernière guerre, pour nombre de jeunes compositeurs aussi bien en France qu'ailleurs en Europe et y compris la Hollande, l'unique salut pour l'avenir.
Poulenc, lui, fut un homme infiniment intelligent, et il ne faut surtout pas se tromper, mais en même temps le contraire d'un cérébral ou d'un idéologue. Ce fut un instinctif et en même temps un éclectique, un pragmatique qui, un peu comme une abeille, cherchait et suçait l'essence ou la substance de son inspiration partout où le vent voulait bien le mener. On peut déceler ainsi dans son oeuvre des traits ou des traces de Debussy, bien sûr, aussi bien que d'un Stravinsky, d'un Chabrier, d'un Monteverdi ou, répétons-le, d'un Couperin qui se trouve en particulier très présent dans telle Suite française ou le Concert champêtre pour le piano.
Mais tout pragmatique qu'il fût, Poulenc n'était nullement pour autant un omnivore, et on pourrait citer plusieurs maîtres patentés qu'il n'appréciait que très modérément ou qu'il détestait carrément.
Richard Wagner se trouvait parmi eux, tandis qu'il sentit pour l'immense génie de Jean-Sebastien Bach, bien sûr, la vénération | |
[pagina 78]
| |
 qui s'imposait, mais en même temps une tendresse vraiment très, très limitée. Il s'en est exprimé avec sa franchise coutumière et même avec beaucoup de courage dans ses très intéressants Entretiens avec Claude Rostand, quand il fait, au sujet de ces problèmes d'architecture musicale, quelques remarques extrêmement judicieuses. ‘Les compositeurs français, dit-il, cachent par élégance les plans de leurs constructions et c'est ainsi que l'Europe centrale peut nous faire le reproche de notre manque de forme. Mais lorsque la forme, celle d'Outre-Rhin, veut endiguer la musique française, elle la noie: voyez les sonates de d'Indy ou de Dukas à jamais écoulées, alors que les esquifs, en apparence frêles, des pièces de piano de Debussy et de Ravel défient les tornades de la mode.’ Et sans les désigner nommément, il me semble que Poulenc aurait pu placer dans cette même catégorie de blasphémateurs germaniques de la musique française ces maîtres de l'école de Vienne comme Schoenberg et von Webern, qui se trouvaient en tout cas assez éloignés du champ d'action personnel de notre compositeur. Et il faut bien reconnaître que ce manque de compréhension, sinon cette aversion à l'égard de bien de musiciens germaniques de la part de Poulenc, la nouvelle génération de jeunes loups comme un Pierre Boulez, un Leibowitch ou un Stockhausen, lui en rendit bien la monnaie. Il y avait donc indubitablement une manifeste incompatibilité fondamentale entre les membres du Groupe de Six, dont faisait partie Poulenc, et les jeunes musiciens sériels ou dodécaphonistes de l'après-guerre. Ce Groupe de Six, il faut bien en dire maintenant encore quelques mots. Contrairement à ce qu'on croit encore souvent, ce ne fut pas à l'origine un collectif de jeunes compositeurs intimement liés entre eux par quelque programme ou plate-forme d'ordre esthétique, idéologique ou philosophique. Le Groupe de Six devait sa naissance plutôt à un hasard. Le hasard d'un titre, trouvé probablement au tout dernier moment au marbre de l'imprimerie par quelque secrétaire de rédaction, pour un article que le critique musical Henri Collet avait écrit, après la première guerre mondiale, pour le journal Comoedia et pour rendre compte d'un concert où ces six musiciens furent joués. Ce titre les compara aux légendaires Cinq Russes, dont Moussorgski et Borodine, comparaison évidemment plutôt avantageuse et même flatteuse, et c'était, par voie de conséquence, donc assez compréhensible que ces six jeunes musiciens français | |
[pagina 79]
| |
à l'affût de reconnaissance et de gloire profitèrent sans vergogne du rententissement de ce lancement. Et c'était bien plus tard que le poète Jean Cocteau s'arrangea pour glisser en dessous de ce groupe une espèce de programme ou de pamphlet-proclamation qu'il intitulait le Coq et l'Arlequin, pour leur imposer en même temps, et à titre de leader ou de patron, leur confrère beaucoup plus âgé qu'eux, ce surprenant Eric Satie. Ce même Satie, dont on assiste actuellement à une révalorisation assez spectaculaire, et je peux y ajouter: surtout en Holande, où on vient même de déterrer pour les traduire et publier tous ses écrits et autres graphismes.
N'empêche que Poulenc, aussi bien du reste que Satie, traduisit à bien des égards dans sa musique de ces annéeslà pas mal de directives ou articles de foi que Cocteau avait formulés à leur intention, et encore tout spécialement ce refus farouche de toute importation allemande. Je l'ai déjà dit et je le répète que Poulenc fut un compositeur profondément, disons viscéralement français et même parisien, et ses oeuvres fourmillent de réminiscences d'un certain folklore parisien, bien que souvent issu de sa propre imagination, et j'y reviendrai encore plus loin. Poulenc fut donc certainement un peu antiboche sur les bords, mais on peut dire également que tous les Allemands, eux non plus, ne le portaient pas toujours dans le coeur. C'est ainsi que le violoniste Theo Olof, qui est le premier violonsolo de l'orchestre du Concertgebouw à Amsterdam, raconte dans ses sauvoureux mémoires comment Poulenc répétait un jour son dernier concerto sous la direction d'un célèbre chef allemand qui, pour ne pas le nommer, s'appela Otto Klemperer. Il régnait alors entre le maestro et le soliste décidémment une incompréhension totale, et à un certain 
Wolgang Wijdeveld (1910).
moment, le chef qui, lui non plus, n'avait pas l'habitude de mâcher ses mots, maugréa en direction d'Olof: ‘Wie sagt man denn noch Scheisse im Französisch?’ Et en se posant cette question, ce maître fit ainsi en même temps la démonstration de son hostilité ancestrale envers Poulenc et de son ignorance hermétique de la langue française, car le mot de Cambronne, autant que je sache, se pratique toujours très couramment dans l'hexagone. Et voilà ce passage du Concerto qui inspira cette sortie fulgurante et dans lequel le voyou se dresse en effet, si je peux dire, dans toute sa splendeur (ex. 1).
Et ce même passage nous fait entrer maintenant dans le vif du sujet. D'où venait en effet cette tendance, ce penchant pour le populo, ce désir de parler argot en musique? D'un côté, probablement, par un certain esprit de contradiction, de provocation, de dandysme pour scandaliser un peu le gros bourgeois et les précieuses ridicules. Mais au fond, Poulenc se sentit quand même aussi très proche d'un certain peuple. En tant que Parisien de naissance, il détestait autant les beaux quartiers de Neuilly ou du 8e et du 16e | |
[pagina 80]
| |

Jan Mul (1911-1971).
arrondissement, qu'il adorait le Marais, la Bastoche, Ménilmontant et certains faubourgs.
Mais Poulenc ne fut pas, bien sûr et de loin, le seul ni même le premier compositeur contemporain à ressentir ce besoin d'ouvrir de temps en temps les portes et les fenêtres de nos temples de la musique pour y faire entrer un peu de cet air frais qu'on peut respirer dehors et dans la rue, et un Stravinsky, un Tansman ou un Gershwin, avant ou après lui, en avaient fait autant.
Mais peut-être que le moment est venu pour m'attaquer maintenant à la deuxième proposition du titre de cet article, pour nous occuper donc un peu des compositeurs hollandais. C'est vrai, en effet, que ce Poulenc, auteur de musique souvent très terrestre, charnelle, populaire et antisavante, a inspiré plusieurs compositeurs néerlandais, dont je pourrais citer d'abord un Jan Mul, qui lui était très proche, également sur le plan personnel, ou son confrère Wolfgang Wijdeveld, qui fut de la même génération (né en 1910) et élève du grand protagoniste de la nouvelle musique en Hollande que fut Willem Pijper.
Dans cette même lignée, on pourrait situer également l'aîné des deux frères Andriessen, Jurriaan, et qui est en plus le fils d'un autre, et donc troisième, compositeur très connu, Hendrik Andriessen, et qui fut longtemps directeur des conservatoires d'Utrecht et, plus tard, de la Haye. Jurriaan Andriessen, lui, a passé, après la dernière guerre, quelque temps à Paris dans la classe d'Olivier Messiaen, avec lequel, du reste, il ne sentit que très peu d'aspirations en commun, avant de partir pour l'Amérique, où il travailla avec l'illustre compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, qui lui était certainement beaucoup plus proche et qui créa, à New York, ses Berkshire-symphonies, oeuvre plus qu'attachante et qui a bien tenu ses grandes promesses. Comme pour Bernstein, pour Jurriaan Andriessen il n'y a pas, ou il ne devrait pas y avoir une quelconque frontière ou démarcation entre la soi-disant grande musique et l'autre, car pour lui, comme du reste pour Poulenc, il n'existe que de la bonne musique et puis de la musique ennuyeuse, la musique qui rase. Pour les compositeurs de la génération suivante, Louis Andriessen (né en 1939) et Peter Schat (né en 1935), la question de leurs rapports avec Francis Poulenc se pose, à vrai dire, sous un jour bien différent.
Les résultats tangibles ou sonores chez l'un et chez les deux autres, et surtout chez Louis Andriessen, peuvent paraître en effet quelque peu similaires et encore..., sans que cela empêche que les motivations, elles, restent néanmoins plutôt très divergentes. Je m'explique. Peter Schat, qui fut élève de Pierre Boulez, est connu comme le chef de l'école dodécaphoniste en Hollande, à laquelle appartient, ou a appartenu, également Louis Andriessen. Peter Schat vient de | |
[pagina 81]
| |

Jurriaan Andriessen (1925).
m'assurer qu'il reste toujours scrupuleusement fidèle à ces options sérielles, tout en admettant que sa musique soit devenue aujourd'hui peut-être un peu moins ésotérique et par ce fait plus accessible à un public non initié et donc plus étendu. Mais il se défend furieusement de vouloir composer pour les ‘happy few’ et il nie avec autant d'insistance de pratiquer une musique élitaire.
Moi, je veux bien. Mais il en reste, me semble-t-il, cependant un hic, et même un hic de taille. Car on ne peut, hélas, nier que les gens qui sont en possession de ‘la culture’ dans le contexte de laquelle l'avant-garde doit quand même se placer, continuent de former toujours une entité sociologique ou une classe bien à elle, qui n'est pas ce qu'on appelle ‘le peuple’. Françoise Giroud, l'ancienne secrétaire d'Etat à la Culture en France, a comparé récemment cette classe avec le Jockey-Club, qui est donc un club bien fermé. Et à ce propos, elle a en plus fait une remarque qui me semble, encore une fois hélas, trop justifiée, en disant qu'elle croyait que ceux qui sont à l'extérieur de ce club n'ont nullement envie d'y rentrer, et qu'il y a dans cette façon de les inviter une sorte de condescendance qu'elle estimait plutôt déplaisante.
En me retournant maintenant de nouveau vers Peter Schat, je ne veux nullement lui chercher une mauvaise querelle et encore moins lui faire un procès d'intention, car ses mobiles sont sans doute aussi purs et même nobles que ses talents de compositeur sont considérables.
Mais sa situation reste néanmoins très, et je dis même tragiquement paradoxale. Avec Louis Andriessen, Peter Schat fait aussi partie d'un groupe d'activistes qui s'inspire de la philosophie marxiste, sinon gauchiste, et dont l'un des objectifs est d'arracher la musique ou la culture en général, en tant que monopole, des mains de la classe dominante, autrement dit de la bourgeoisie. Pour y arriver, ils ont organisé par le passé plusieurs manifestations d'action directe dans le Concertgebouw et ailleurs, mais ils ont également agi d'un façon, mettons, plus constructive. L'oeuvre collective qu'ils ont monté sous le titre de Labyrinth, il y a plusieurs années, dans le cirque Carré à Amsterdam, a marqué ainsi une date dans la vie culturelle de la Hollande. Et ce même groupe de cinq compositeurs réalisa en 1969 une production à grand spectacle politico-expérimental, qui ne faisait pas moins de bruit, et cela dans le double sens de ce mot. Louis Andriessen, de son côté, forma en plus encore un orchestre à base politique, avec lequel il descendit régulièrement dans la rue pour y exécuter des pièces de son propre ou d'autre cru, mais qui se classeraient assez difficilement, me semble-t-il, sous le signe d'une stricte obédience dodécaphoniste.
Il se produit donc ici incontestablement un conflit entre les exigences musicales comme celles-ci sont dictées par les nécessités d'ordre individuel de l'artiste et, | |
[pagina 82]
| |

Peter Schat (1935).
d'autre part, des mobiles de caractère politique ou social, et ce n'est certainement ni la première ni la dernière fois qu'il se présente ainsi. Il s'agit, en dernière analyse et pour chaque créateur, d'allier le rêve et l'action et il est clair que cette alliance ou harmonisation soit pour un compositeur d'avant-garde et en même temps très politisé encore bien plus difficile à réaliser que pour un artiste moins engagé et qui s'accorde, par ce fait, un peu plus de liberté, ou des droits supplémentaires à l'égoïsme (‘supérieur’ ou non). Francis Poulenc, lui, ne semble jamais s'être creusé la tête, au moins sur la place publique, avec ces problèmes-là. Mais il me semblait néanmoins nécessaire de les mettre bien en évidence du moment que nous avons voulu établir un lien entre lui et ces deux compositeurs. Car, on le sait, si deux hommes font objectivement la même chose ou des choses plus ou moins ressemblantes, cela ne veut nullement dire toujours que leurs intentions, elles, aillent également dans un sens parallèle. On peut se ressembler (un peu), sans être pour autant de la même famille. Et pour démontrer cette ressemblance, voilà deux citations extraites, successivement, 
Louis Andriessen (1939).
du Concert champêtre de Poulenc et de l'Anathema de Peter Schat (ex. 2). Francis Poulenc cherchait et trouvait, comme nous l'avons démontré, souvent une source d'inspiration auprès de ce qu'on a l'habitude d'appeler avec une certaine arrogance ‘le peuple’ et dont il parlait donc l'argot. Chez Louis Andriessen, sinon Peter Schat, qui ne sont d'origine, pas plus prolo que Poulenc, du reste, il s'agit donc foncièrement d'un phénomène très différent. Ils ne cherchent pas à ressembler et encore moins à singer ce peuple, mais je dirais presque à s'identifier, au moins sur le plan politique, avec lui. Je n'oserais pas affirmer qu'ils ont réussi ou réussiront ou qu' ils ont échoué. Mais ce qui me semble certain, au contraire, c'est que ces deux musiciens se rangent, par l'originalité et la générosité de leurs visions politiques ainsi que par leur très grand talent, parmi les compositeurs les plus intéressants de leur génération ou de notre temps. Un temps qui, politiquement parlant, semble plutôt s'éloigner de Francis Poulenc. |
|

