|
| |
| |
| |
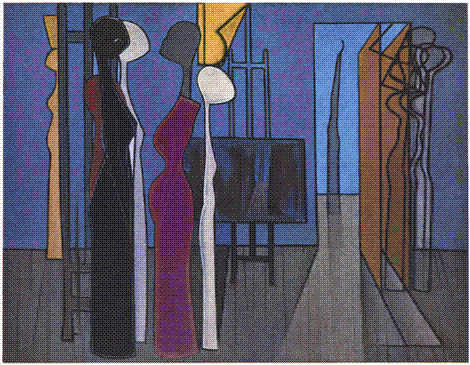
Sintesis par Luc Peire (1953 - collection R. Breen, New York).
| |
| |
| |
luc peire
pierre volboudt
Né à Paris en 1906. Diplôme d'Etudes supérieures de Droit Public et de Sciences Politiques. Ecole des Hautes Etudes (Sorbonne). Ecole des Langues Orientales. Medaille d'or de l'Académie Royale de Suède. Fonction actuelle: Homme de Lettres. Publications principales: Les dessins de Paul Valéry (1948); traduction en français du Spirituel dans l'art de Kandinsky (1949); nombreuses traductions du suédois (notamment de K.M. Bellman) Stockholm (1950); L'oeuvre graphique de Kandinsky (Du Mont Schauberg, Cologne); Les Assemblages de J. Dubuffet (1960, Paris); Les sculptures d'Ed. Chillida (1965) etc. Nombreux essais et monographies sur des sujets d'Art et de Littérature. Collabore régulièrement aux XXe siècle (Paris), Derrière le Miroir (Maeght, Paris), B.L.M. et Konstrevy (Stockholm) et à des revues d'Amérique Latine (Cultures comparées, Arts Piastiques, Littérature).
Adresse:
47, rue de Boulainvilliers, 75016 Paris.
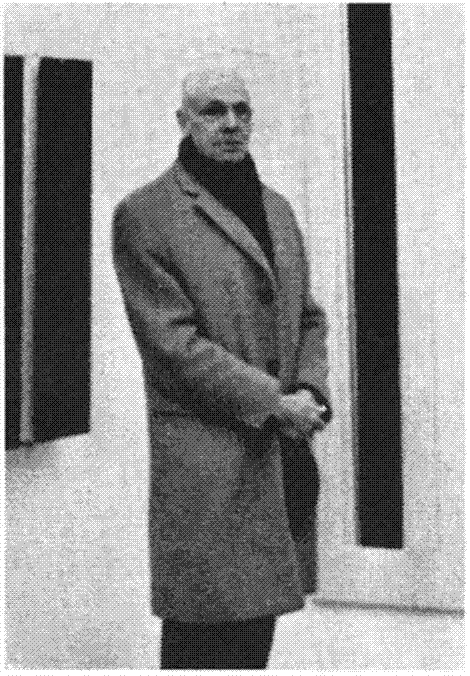
Lignes, tranchants théorèmes, demeures immatérielles de l'esprit, netteté construite, exactes ordonnances de l'arbitraire, l'oeuvre peinte peut être ce lieu abstrait. De ces domaines euclidiens de la règle et de la raison dont chaque figure est la donnée nécessaire, une pièce irremplaçable de la partie qui s'y joue, Luc Peire a fait le sien propre. Mais il y introduit une ambiguïté qui, sous les apparences du dépouillement géométrique, ouvre au milieu des plus claires évidences d'insidieuses perspectives, dissimule un ordre insolite. Un espace règne en ses toiles, en marge du concept qu'habituellement on en a, - espace tenu, tendu par tous les rêts de la rigueur, espace inexprimable, hors de toutes dimensions, rigide et irréel, fluide et fortement charpenté, fuyant en labyrinthes de transparences, répercuté par les plans, les plis, les écrans de la couleur qui n'en sont que les faces perméables, réversibles, les frontières concrètes de ses mouvants et incertains territoires.
Tout artiste se crée une image d'espace. Il en porte en soi les traits. Sa vision personnelle s'élabore à partir de là. Pour l'un, il s'agit d'une illusion plastique qui prolonge la réalité du visible et en exprime l'essentiel, en fixe les mouvements et, dans l'immobile, atteste les mutations de l'instant. Pour l'autre, la toile est le champ d'une transposition de valeurs visuelles, rassemblées et concertantes selon des rapports de pure invention. Un troisième ne le considère que comme une étendue tout imaginaire, douée de propriétés factices et tenant sous sa servitude chacun des éléments formels qui la constituent. Equivalence ou fiction, irréalité tissue de lambeaux du visible détournés de leur signification et n'ayant plus rien de commun avec quelqu'objet que ce soit, aucune
| |
| |
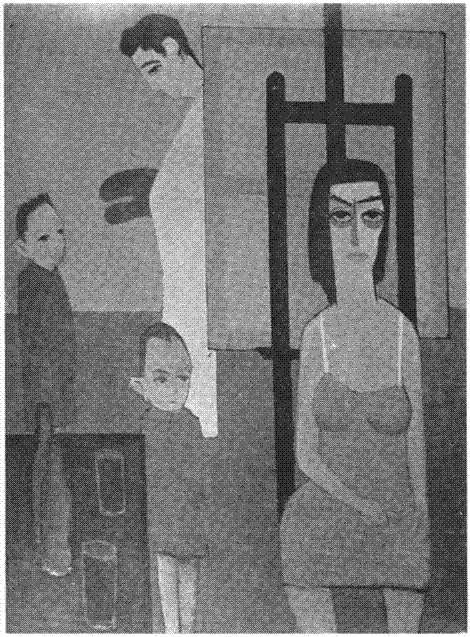
La famille Godderis (1950) par Luc Peire.
de ces solutions, à elle seule, ne convenait à Luc Peire. Son univers pictural s'est élaboré par une quête patiente, attentive à cela d'unique et de difficile qui répondait à son exigence secrète. Des rencontres, des expériences le confirmèrent dans un dessein qu'il ne savait pas, au départ, être le sien. Nulle décision concertée, mais une intense réflexion sur les problèmes que la peinture lui posait. Ni emprunts ni concessions, des étapes franchies sans hâte, avec une détermination lucide, jusqu'à l'entière possession de ses ressources, la maîtrise achevée de son art.
Un thême domine l'oeuvre. Omniprésent, il en est la clef, la composante fondamentale qui se prête à toutes les combinaisons, aux variations inépuisables que l'invention du peintre tire d'un infini de lignes. Essence, image-force de sa création, la verticalité est bien autre chose qu'une manière de peindre. C'est l'axe d'une démarche spirituelle, la représentation d'un monde parallèle, monde de parallèles que l'artiste ne veut voir que comme un modèle d'univers en qui tout, à ses yeux, se décompose, se recompose en raies inexorables dont pas une ne dévie, ne relâche sa tension, n'infléchit son tracé, et dont la dynamique se résout dans la répétition obstinée de l'Un et de ses multiples.
Avant que de se connaître, de se reconnaître, quel créateur s'imprègne d'un afflux d'épisodes propices que sa conscience ne filtre que peu à peu? Il réagit aux uns et les accepte, refuse les autres. Une masse contradictoire de certitudes fortifiées par leur mise à l'épreuve et les doutes mêmes qu'elles proposent, s'amasse. Mais, à son insu, déjà, il a pris parti. On ne saurait parler d'influences, car elles sont encore trop mêlées, incomplètes, ne durent que le temps de les éprouver et, l'initiation terminée, de les rejeter. Parmi elles, le milieu agit comme un réactif qui, par contraste, fait apparaître une tendance ignorée, prête à s'épanouir. Il est une atmosphère vitale, chargée de prémonitions qui ne se liront en clair que plus tard, lorsque l'artiste aura découvert sa voie et s'interrogera sur son itinéraire antérieur.
Enfance à Bruges, exemple d'un père artiste lui-même, ciseleur de bois, savant en l'art de jouer du droit fil et du bois debout, un oncle amateur de peinture et de musique, quelle meilleure préparation pour un enfant qui rêve sans l'avouer, sans se l'avouer
| |
| |
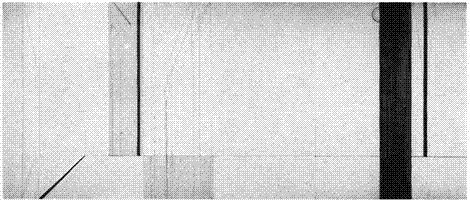
De kille stad (1956, collection Vermeire, Zwevegem) par Luc Peire.
peut-être, de faire sien cet univers mystérieux des formes qu'il devine vaguement se construire au travers de la réalité à laquelle s'ouvrent ses yeux? Longtemps après, Luc Peire se souviendra de l'outil aux mains de son père, incisant le chêne, de la minutieuse précision de l'ébéniste préfigurant son travail à lui, creusant ses rais perpendiculaires dans une matière bien différente, celle de son époque, neutre et froide, mais vibrante sous les mille cordes, les calmes, les graves notes de ses tablatures en noir et blanc.
Jamais non plus, il n'oubliera ces pans de murs discrètements peints, ces façades, ces alignements verticaux qui se dédoublent dans les eaux plates des canaux, réalité linéaire, sans assise que le seuil insensible de la nappe liquide où s'enfoncent, à peine remuées de reflets, de hautes immobilités sans fin. Sans doute, à certaines heures, a-t-il pensé au blanc dédale des dunes, à leur sable ridé d'ombres et, dans les terres, aux lignes de fuite des routes et des rives inflexibles, allant se confondre, hors du regard, en quelque point abstrait du butoir impénétrable de l'horizon, parfois coupées de l'obliquité d'un rayon transversal, tangent à la courbure implicite de la traversée du trouble miroir de l'air.
Obscurément, se préparait dans la sensibilité du jeune peintre le choix radical qui devait engager son oeuvre future et en faire la synthèse architecturale d'une sereine vision du réel. On peut supposer que l'enseignement des écoles d'art, quelque profit qu'il en ait retiré, excita chez Luc Peire le besoin latent d'une vérité qu'il pressentait, qu'il cherchait et dont les modèles lui manquaient. C'est alors qu'il connut Permeke. Il en reçut de robustes et salutaires leçons. Ce qu'il avait appris fut ébranlé. Choc décisif. Enfin, la vraie peinture, devant lui, prenait chair, vivait et respirait d'un souffle puissant. Tout le reste n'était plus qu'exercices d'école. Auprès de ce sensuel pétrisseur de la matière picturale, il connut les vertus, les violentes, les savoureuses délices de la
| |
| |
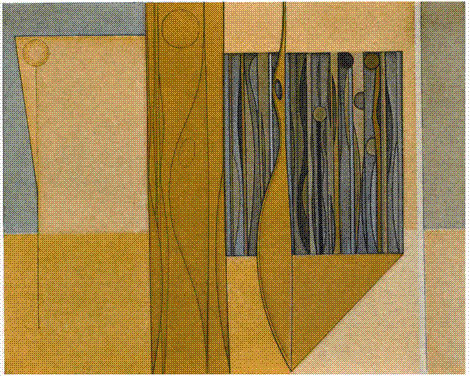
Mwinda Mingi par Luc Peire (1955 - collection M. Naessens, Bruxelles).
| |
| |
couleur. Les sourdes résonances des terres, des ocres, des bruns de cet art sobre et sombre, les abruptes figures que Permeke taillait en frustes effigies de l'élémentaire dans la masse pesante du sol, engluées de glaise et de glèbe, séduisirent Luc Peire. Cette révélation soudaine abolissait ce que ses années d'apprentissage avaient opposé à sa curiosité et à son impatience.
Il lui restait à découvrir sa véritable voie. Permeke, par ses rudes boutades, l'avait engagé dans l'épaisseur d'une réalité ancrée de toute sa masse dans le quotidien, où l'espace, étouffé sous la carrure de la forme, muré par la matité des tons, n'existait pas. L'issue vers les arrière-plans de la couleur, les échappées dans l'encadrement des volumes et des surfaces sur les amples vibrations de la lumière, ce fut la simplicité géométrique de Giotto qui lui en montra le chemin. Le Primitif l'instruisait des plus modernes audaces. L'équilibre harmonieux des inégales valeurs colorées détermine chez le Florentin des portions d'espace à la fois clos et aéré, diaphane et plein. La densité semble même y céder au vide. Instantanément, le peintre se sentit confirmé dans sa recherche. Il sut que là était la direction qu'il avait demandé, vainement jusqu'alors, à d'autres.
Après l'oeuvre des Maîtres, les scènes et le décor de la vie du Midi méditerranéen achevèrent sa conversion à la sobriété de l'articulation des parties de la composition, à leur orientation calculée, à la partition de la toile en grandes plages unies, génératrices de contrastes et d'accords, d'intensités consonantes. Au Maroc, la chaux vive des murs des Médinas, les jointures de leurs faîtes sur le bleu dur d'un ciel qu'on dirait encastré en chaque angle qui les échancre en façon de charnières subreptices, les légères décolorations de toutes les teintes du jour, Luc Peire les regarda comme des projections dans une étendue quasi abstraite des variances d'un chromatisme soutenu, armé, divisé par la netteté catégorique du trait, annonce de sa peinture à venir. D'Afrique, il rapporta, peut-être, l'image de ces silhouettes sveltes et cambrées qui se profilent sur l'éclat décoloré du ciel, leurs minces ombres méridiennes à leurs pieds.
L'art du peintre s'affirme et se définit. La couleur se décante; la forme se durcit dans le cerne abréviatif qui l'enlace. Elle tend à se faire de plus en plus stricte par l'emboîtement des schémas rigoureux auxquels êtres et choses se réduisent. La substance du réel se transmue. Murs et meubles, les gestes même, sont liés entre eux par un réseau de droites fortement souligné, de répliques et de simultanéités concurrentes. La figuration renoncée, ou sur le point de l'être, des traces en subsistent encore. Des figures hantent ces places vides, ces ateliers d'où le peintre semble absent; mais ce sont des ‘ombres’ de figures, simples découpes linéaires qui, bientôt, se résorberont dans la ligne indivise, avant de disparaître pour toujours.
Dans ces ‘intérieurs’ dont on ne peut dire si les parois qui les enferment ne sont pas des limites toutes conventionnelles que l'imagination peut transgresser à son gré, des personnages hiératiques tiennent de muettes assemblées. Ils évoquent on ne sait quelle théorie de ‘dames blanches’ gravées sur le roc, dans la vacance sans bornes des déserts ou le défilé de figurants d'un rituel pharaonique. Le corps n'est plus que l'hiéroglyphe de l'être. Seul compte le trait délié par quoi
| |
| |
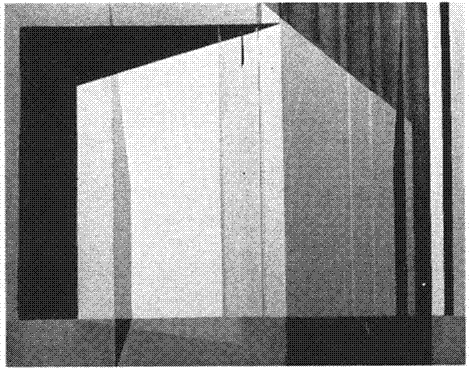
Escurial (1962, collection C.N.A.C., Paris) par Luc Peire.
il s'insère dans le cartouche, sa chambre d'éternité. La tête somme de son disque le triangle sinueux, à peine évasé et s'effilant jusqu'à l'aigu. Les saillis du vivant s'étirent en étroits rubans de deux lignes qui viennent à presque se toucher. Le cercle qui le couronne s'estompe en halo. Il subsiste encore en 1957 (‘Imuthes’), mais rétracté en un point noir dont la minuscule sphère ponctue le fuseau transparent. La métamorphose de la ligne s'achève. Désormais, elle sera tout. A l'exemple de Kandinsky qui, du gisant des premières ‘Compositions’, a fait cette courbe cinglante en mèche de fouet qu'on retrouve identique, inévitable dans les oeuvres dernières, Luc Peire passe de la forme lentement déshumanisée à son sigle simplificateur.
‘Het Nieuwe Rijk’ de 1956 est le point tournant de cette évolution. Les derniers restes d'une figuration qui n'est plus qu' une algèbre formelle, s'effacent. Ils persistent, comme en filigrane entre les vigoureuses architectures qui s'ébauchent et vont dominer. Enfin, la mutation est consommée sans retour. Les rouges orangés de ‘Ramses’ (1961), ses bistres estompés de gris, un écart de bleu pâle, l'obliquité fulgurante d'un blanc traduisent la véritable réalité que cet art consent à reconnaître, la présence unique, multiforme qui emplit la scène picturale: l'espace. Immobile, configuré par les hauts portants, les portiques qui l'enserrent et qu'il déborde de partout, il est entre eux, en deçà ou au delà, impondérable, indivisible, cloisonné par la couleur et, selon ses impérieux cheminements, sans cesse la contenant et refermant sur elle sa puissance intacte, inaltérée.
L'artiste est entré dans le domaine illimité du nombre et de la mesure. Il ne le quittera plus et s'en assurera la possession en lui donnant une dimension inattendue. Il y développera les complexes variantes du Même indéfiniment recommencé. Il avancera dans le déploiement de textures d'espace. Subordonnés à l'ordre des grandeurs et des différences, des proportions et des accords, l'étal des couleurs, les vastes lés de rouges et de bleus, les jaunes incandescents, les gris cendrés y sont subordonnés à la primauté de la ligne. Ni contour, ni suture de plans, elle est et ne doit d'exister qu'à la volonté, à la sensibilité de celui qui la crée et, autour d'elle, l'espace. Loin de s'y incorporer, elle s'y inscrit et garde son autonomie. Groupée en faisceaux sur les étroites bandes de la couleur qui avancent, reculent à la lumière des membres d'un édifice implicite, elle apparaît plutôt comme un linéament d'espace entretissé dans l'embrasure d'une absence d'espace. Le plus souvent, à l'écart, elle édifie de fines épures ténues, infinitésimales, que, sans les affecter, une fluidité indifférente traverse.
Sur champ de couleur, tout se réduit à la ligne, à la droite. Ferme, inflexible, elle se
| |
| |
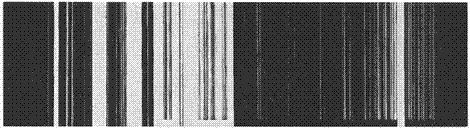
Graphie 1010 (formica, 1965) par Luc Peire.
répète, diversifiée par son ‘corps’, depuis celle qui serait mieux dite barre ou tronçon, jusqu'à celle, arachnéenne, qu' on croirait prête à se dissoudre, à s'évaporer dans la blancheur. Ce raffinement est la ressource de l'artiste. Enchâssée dans l'appareil des lignes, il organise l'étendue colorée; il la partage, la sectionne en travées, les juxtapose. Il solidifie en cette place, ménage ailleurs une éclaircie, attise le tranchant d'une faille. Il plante, ici, une hampe nue. Il trame, là, une longue gamme d'harmoniques et de discontinuités dont la tension, au travers de leurs intervalles, demeure uniforme. On pense à ces roides sonorités, à ces timbres, à ces longues ‘tenues’ sans défaut qui se succèdent, montent d'un jet irrésistible et retombent, et font d'un Ockeghem le prestigieux artificier d'une aride polyphonie de sons purs.
La ligne, la ligne seule, confrontée à la couleur, comment soutenir, tout compromis refusé, ce périlleux parti-pris? Oser, comme le fait Luc Peire, la prendre comme objet unique, nécessaire, suffisant, de son art, suppose une exigence peu commune à l'égard de soi-même et la force de ne la jamais renier. Dans son oeuvre, la ligne n'a d'autre raison que soi, but et moyen tout ensemble. L'art naquit avec elle et la tache fut son prolongement. Mais la ligne n'est nulle part dans la nature. Elle est partout dans l'oeuvre de l'homme. Il ne voit la réalité que délimitée par son abstraction. Lacet de l'apparence, piège et possession par l'acte et le commandement de l'esprit qui l'invente et la plie à son mode particulier de convertir ce qu'il extrait du monde qui l'entoure en son intime et exclusive possession. La ligne est forme, pourtant. Les formes en sont faites. Elément premier, terme sommaire qui entre, même sous-entendu, dans les structures plastiques toujours réductibles à l'abstrait. Elle définit, mais, d'abord, elle se définit. S'en déduisent, l'infini des combinaisons, des valeurs dont elle est capable, l'imprévu de ses possibles. ‘Une seule ligne se prononce et tout l'univers est ébranlé.’ Et Kant fait écho à ce maître de l'encre de la Chine millénaire: ‘Le Beau abstrait est en la ligne’.
Une telle pensée pourrait être la devise de Luc Peire. Toute son oeuvre l'illustre. Mais une ligne vaut autant par ce qu'elle est que par ce qu'elle rature, par l'imprécis qu'elle souligne, qu'elle rehausse, qu' elle raie de son ‘imperatoria brevitas’. Davantage, semblable à une note indéfiniment prolongée dans le silence où elle
| |
| |
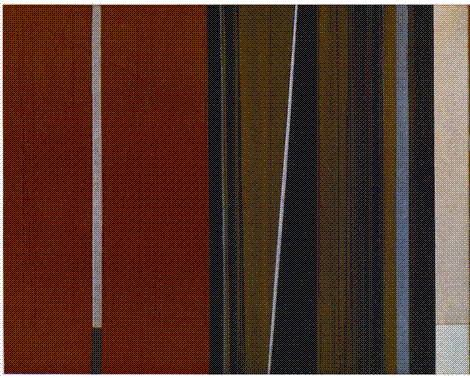
Ramses par Luc Peire (1962 - collection Dr. Gyselen, Leuven).
| |
| |
n'appelle aucune assonance, il lui faut, pour renforcer, étendre ses pouvoirs, s'accompagner de quelqu'autre ou de la couleur, ses complémentaires. Une seule y suffit. Une tension se crée qui, de proche en proche, éveille une sorte d'harmonie rudimentaire entre l'écho et sa source, entre la vibration la plus forte et celle qui s'émeut à son tour, la soutient et, dans l'inégalité, l'équilibre. De ce constat, le ‘verticalisme’ de Luc Peire se déduit. La pluralité des lignes forme une table de résonance qui se superpose à la ‘basse obligée’ de la couleur. Sur ce fond éclatant ou baissé en sourdine, des rythmes se propagent. Une partition plastique se déchiffre d'un seul regard; on en embrasse l'étendue entière, on en devine les prolongements tacites au delà des limites du tableau. Un temps immobile s'y morcelle en temps secondaires, en séquences qui donnent l'illusion d'un déroulement continu, de phases, de pauses, de haltes dans une immuable durée.
Mais un insensible décalage semble perpétuellement remettre en question l'ordonnance irréfutable. Des perspectives elliptiques et communicantes ouvrent de fallacieuses profondeurs. Une action formelle se déclare. La ligne, devenir en puissance, énergie consumée dans son accomplissement, instaure tout un mixte de versions, d'interpolations, qui s'échelonnent, identiques, différentes d'aussi peu que l'on voudra, à des distances dont il est bien malaisé de dire si elles existent ou ne sont que phantasmes. Dedans, dehors, envers, endroit s'excluent et coexistent, se confondent par rabattements, permutations conjecturales, géométriques anamorphoses. Des aires lumineuses s'érigent, tout illuminées de cette clarté égale en qui le proche et le lointain n'ont plus lieu et qui, aux dires du poète, ‘blanchit l'esprit’. La clarté abolit dans l'instant ce que l'illusion perfidement suggère. Nulle ombre ne fournit de repère. Tout ramène à une évidence qui trouble et comble l'intellect. On assiste sans interrogation, à l'apparition de ces Fata Morgana qui ne doivent rien aux hasards de l'approximatif, mais sont l'effet d'une combinatoire infaillible, le reflet des nuances et des subtilités de la rigueur.
En ces espaces problématiques, chaque fraction est à la place juste qui lui est assignée, chaque détail réglé comme sur une scène abstraite où le décor serait une manière de protagoniste impersonnel de qui le rôle n'est que de singnifier l'interdit qu'impose l'anonymat du lieu. Rien ne se passe, rien ne se peut passer. L'évènement a pris figure de fatalité. Des panneaux s'entr'ouvrent, derrière lesquels il n'y a, mais séparés par quel intervalle? qu'une seconde et hermétique continuité, ou le néant de la non-forme. La toile devient l'épure, le mirage de quelque cité imaginaire, bâtie des songes de cette rigueur en quoi se transmue la vision de l'artiste. Ossatures aiguës de volumes projetés hors de toute étendue, nervures au plus vif de la couleur, piliers de force incisée à la pointe du pinceau de longues stries rectilignes, membrures du vide, sites indéterminés dans un espace absolu, émanent une austère sérénité. Les sanctuaires de la Grèce ancienne avaient leurs doubles dans le ciel, figures simplifiées, simplificatrices d'une géodésie divine. Luc Peire fait de certains de ses souvenirs, d'impressions méditées, une espèce de triangulation, précise et imprécise tout ensemble, de la sensibilité. ‘Olympos’ est une enceinte évasive à force de
| |
| |
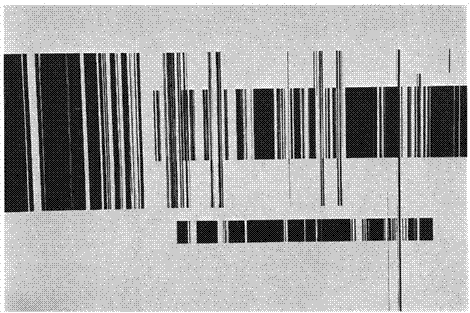
Graphie L (peinture formica, 1965, collection R. De Brock, Knokke) par Luc Peire.
clarté; ‘tout est brûlé, défait, reçu dans l'air’ et reconstruit en ses linéaments essentiels. La ‘Ville sur pilotis’ échafaude ses plans, ses agrès en courtes diagonales étagées à toutes les hauteurs des perpendiculaires qui supportent les trapèzes d'une étrange voilure pétrifiée. On se prend à douter si d'insidieux interstices ne s'insinuent pas entre ces parois à l'équerre, à demi oblitérées par un glissement suspendu ou si les deux plans, inexplicablement, n'en font qu'un. Un infléchissement fréquent des marges équidistantes qui s'intersectent, rompt le parallélisme du dédale où erre le regard mis, malgré sa défiance, en défaut par des équivoques calculées. Ces défilés, ces enclaves, ces passages à l'intérieur de la couleur ne sont-ils que fictions, rêves anti-euclidiens d'un architecte de l'impossible pour qui tout est simultanément ‘intus et extra’?
Qu'elles se dressent dans la limpidité cruelle d'une transparence d'où l'ombre est bannie, qu'elles gravent leurs arêtes comme, sur une vitre, un diamant décalque des fantômes de chambres que le soleil traverse et colore d'un invariable feu, ces ‘demeures’ suggèrent parfois une attente. Certaines sont désertes et faites pour l'être. D'autres sont à l'image d'une
| |
| |
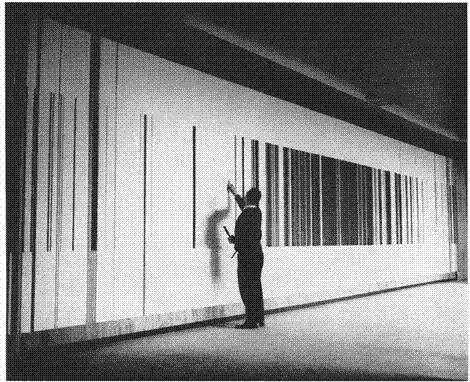
Graphie Europe (formica, Hallen, Courtrai, 1965) par Luc Peire.
ascèse qui s'y concentrerait dans l'envoûtement de la solitude et de l'écart.
L'espace s'y rétrécit, laminé par les opaques coulisses de l'imaginaire. La couleur avance au premier plan. Les plis de ses lourdes et régulières coulées que dérangent à peine de rares obliques, dévoilent seulement de cet espace dont elles diversifient ailleurs les surfaces, ce qui, dans l'ouverture qu'elles lui laissent, se montre et se dérobe à toute empreinte formelle. Une scénographie de la litote est prête pour le drame abstrait de ce vide menacé et triomphant par son indifférence souveraine. La haute fente blanche qui, dans ‘Felipe II’ barre le contre-jour tragique, tapissé de cendre et de grisaille qu'un geste invisible semble sur le point de repousser, pourrait être le masque d' une volonté hautaine, murée dans la
| |
| |
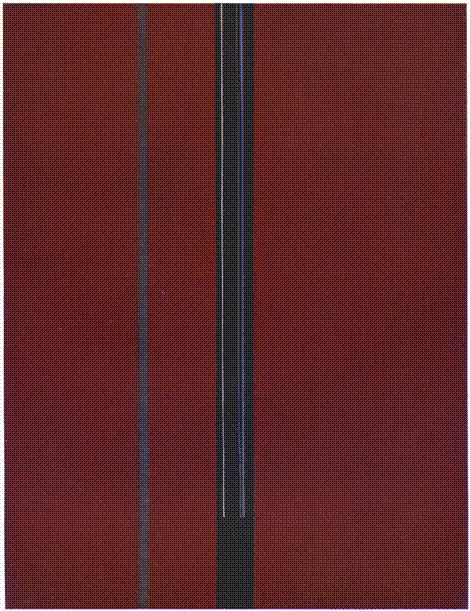
Rubicon par Luc Peire (1968).
| |
| |
somptuosité de son dénuement. L'obscure tenture mordorée de ‘Stuart’, ne la dirait-on pas prise à revers par l'ardente lueur d'une aube qui, dans l'entre-deux, la pénètre et l'imprègne? Face à face, affrontés, dans la toile intitulée ‘Manolete’, une lame rougeoyante et l'élan massif d'un fût quasi minéral que la lumière tourne afin d'en faire saillir l'énergie comprimée, sont les antagonistes d'une sorte de défi, d'un bord à l'autre de l'arène que resserre la chape ténébreuse où s'embusque le destin. ‘Sodome’, désert de braise et de bistre que foudroie un trait aveuglant d'outre-monde, ‘Nocturne’ où brille et luit le scintillement bleuté d'une pénombre qui gagne et perd contre le dur envahissement de noirs accords, toujours, dans ces toiles, une immanence pèse et s'épand.
L'être invisible et sans forme, sous-entendu, pour qui sont préparés ces fastes, ces cilices, celui qui, de l'extérieur, assiste à ces actions dont le ressort secret lui est refusé, vont se voir proposer d'entrer dans le jeu. Dans le même temps que l'irradiation des rouges, les jaunes enflammés s'apaisent en nappes profondes de bleu, le noir et le blanc imposent leur dualisme fondamental, engendrent des suites de valeurs antithétiques. Ils se succèdent en mesures démesurées, en frises qui ne s'interrompent que pour renouer, par delà les césures du silence, leurs irrégulières cadences. L'illusion de l'espace entre les plans qui s'occultent est ramené à sa plus simple expression. Elle naît seulement des interférences des surfaces, des imbrications parallèles des traits. Nulle oblique ne propose plus un recul vers l'irréalité tangible d'un espace variable, alternatif. Aucun arrière-plan n'incite le regard à s'aventurer hors des sentiers
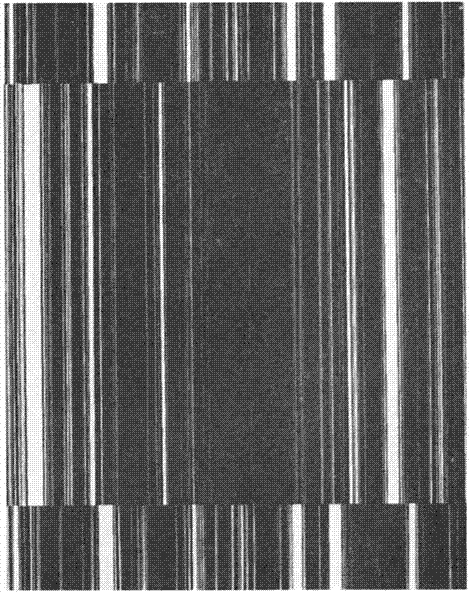
Graphie 1092 (formica, 1971, collection E. Cook, Washington D.C.) par Luc Peire.
battus de la perspective, à passer d'un côté à l'autre du miroir. Sans quitter le poste fixe du spectateur, il assiste au déroulement irréfutable des lignes et de leurs alliances avec cet absolu qu'elles contredisent, mais qui les nuancent et les exaltent.
Comment réintégrer cette métrique de concises parallèles dans le dérèglement contrôlé de toutes les dimensions? Luc Peire inventa de construire une chambre cubique où l'image plane se soude continûment à elle-même et, par ce que J.L. Borges nomme ‘la fécondation des miroirs’, va à l'infini, du thème graphique fait une portée d'espace. Des six faces de cette nouvelle ‘Prison’ d'un Piranèse géomètre,
| |
| |

Environnement (collection Etat Belge, 1966) par Luc Peire.
celui qui s'y enferme ne peut dire, au premier abord, laquelle est peinte et laquelle le reflet. Il s'y trouve suspendu, aspiré par l'éblouissement d'un abîme qui ne commence ni ne finit. La question n'est plus de savoir si une perspective feinte pose ses dilemmes insolubles par l'artifice du peintre. Le spectateur est devenu acteur. Compromis dans un singulier trompe-l'oeil, il se voit, de tous côtés, répétant le même geste, entouré de symétriques sosies, personnage innombrable précipité, tête-bêche, au coeur de l'ubiquité. Reclus entre les barreaux des traits qui convergent vers un apex inaccessiblle, un double vertige l'écartèle, l'un enfoui sous ses pieds, l'autre culminant à l'apogée.
Cabinet de réflection, l'‘Environnement’ de Luc Peire est aussi une cellule propice à la réflexion. On y expérimente d'autres états de cet espace devenu l'espace de la peinture, entravé, dilaté, mais canalisé, cristallisé dans une fuite égale et nulle. Jalonné de reprises dont la somme indistincte se confond avec les trajectoires noires et glacées glissant dans l'insondable, il met celui qui s'y risque à l'intérieur d'un simulacre d'étendue où le corps est
| |
| |
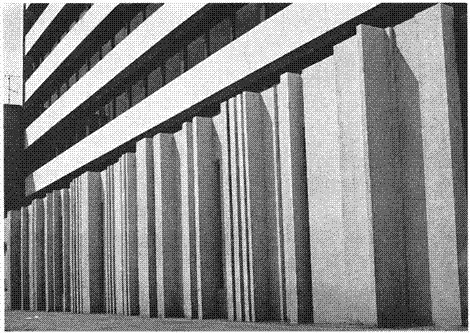
Mur-Relief (Van Breda et Co, Anvers, 1968) par Luc Peire.
le jouet d'une espèce de lévitation sans risques, non sans malaise. Le visiteur est l'obsédant témoin du spectacle qu'il ne peut regarder qu'à la condition de se reconnaître comme un élément, presque un accessoire de cet Opéra où se joue, jusqu'à l'hallucination, la sévère féerie de la duplication du Même en proie aux troubles tentations de l'espace. Dans cette Galerie de glaces, des rêves que la peinture, aidée de quelques subterfuges, ne pouvait que simuler, se matérialisent. L'être se sent dépossédé de ses certitudes les mieux assurées. Il se donne l'illusion de se livrer, sans parapets, aux défis que, sur les tableaux noirs de la science, une formule, une courbe ne traduisent qu'en vertiges de l'esprit.
D'un tel art, il n'est pas excessif de dire qu'il dépasse, par la restriction extrême de ses moyens, par ses contraintes volontaires et la notion cardinale qui l'inspire, l'idée qui continue d'avoir cours de la chose peinte. Peinture, et de la qualité la plus raffinée, allant à l'exquis sans renier rien de sa puissance édificatrice, de l'élliptique ampleur de ses conceptions, mais peinture qui peut prétendre à être, par la
| |
| |
magie qu'elle ouvre, le seuil d'une transcendance. Des règles tyranniques, une résolution autoritaire qui n'admet pas de compromis, l'a conduite à n'user que du clavier le plus rebelle aux séductions de la couleur. Deux valeurs le composent, et, redoublées, associées, scandées en accords compacts, amenuisées jusqu'à l'impondérable, toutes les harmoniques de ces deux sons purs: le blanc et le noir.
Leibniz soutenait que le un et le zéro pouvaient, à eux seuls, tenir lieu de tous les nombres. Du blanc et du noir, Luc Peire a fait la substance de sa vision intérieure. Il en constitue les grilles de cet espace qu'il a donné pour objectif premier à sa peinture de saisir, au delà du nombre et de la forme, de traduire dans son essence. Espace, fibre frémissante d'espace, ce trait qui, de part en part, le traverse et l'innerve; espace, chaque écart coulé entre les irrécusables étais plantés dans l'indéterminé; espace encore l'illimité qui les porte, les soutient, les attire, les environne, ainsi que l'homme qui obéit au vieil ordre éternel de fixer en haut son regard. Par l'étroite observance qu'il sert et qui régit son oeuvre entière, Luc Peire atteint au degré suprême du dépouillement méthodique, paré des austères prestiges de la rigueur.
Il n'est pas jusqu'au béton lui-même à qui l'artiste n'incorpore les vertus et les rythmes de cette poétique des vides et des pleins, du relief et des lacunes intercalaires qui en accentuent les modulations. Sur une façade d'Antwerpen, des éclairs longitudinaux d'espace pénètrent l'édifice; ils rendent sensible, par les chutes verticales de la lumière et de l'ombre, la spacieuse présence qui est le milieu de l'homme, sa hantise et sa tentation inassouvie.
N'est-ce pas un mystique flamand qui a dit: ‘Allez à l'absolu par des voies droites et sans détour, mais emportez avec vous les couleurs et les délices sublimés du monde.’ Il n'est pas, pour un créateur, de plus haute discipline et, s'il accepte de s'y soumettre, de plus rare réussite.
Luc Peire, né à Bruges, le 7 juillet 1916. Après des études à Gand et Anvers, il fait la connaissance de C. Permeke. Dès 1947, il vayage et travaille en Italie, en Espagne, en Afrique et aux Iles Canaries. En 1959, il se fixe à Paris. L'hiver 1965-66, il travaille à New York pendant 6 mois. Il réalise son ‘Environnement’ qui est présenté au Musée National d'art moderne à Paris en mai 1967, et à la 34e biennale de Venise (Prix Gavina). En 1968, il réalise ‘Ambiente Mexico 68’ pour le Museo de Arte Moderno de Mexico. Il collabore avec des architectes, des cinéastes et des poètes. Plusieurs distinctions. Nombreuses expositions dans le monde entier. Adresse: 38, rue Falguière, Paris 75015.
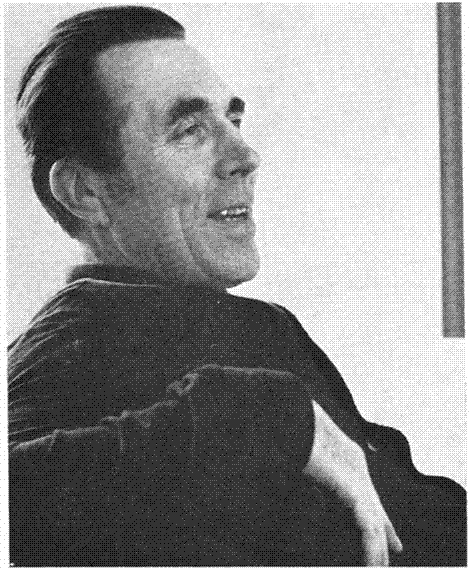
Luc Peire (photo de Jean Mil, Oostende).
|
|