|
| |
| |
| |
Troisième époque.
La bataille de Roosebeke, où le second Artevelde et ses compagnons succombèrent sous le nombre, fut la dernière grande entreprise des Flamands contre la France. Un demi-siècle plus tôt Jacques Artevelde avait formé une ligue formidable contre ce pays qui nous convoitait sans cesse; mais une inconcevable fatalité accrut insensiblement l'influence de notre ennemi naturel, non-seulement sur la Flandre, mais sur un grand nombre d'autres provinces limitrophes. Partout dans les Pays-Bas surgirent la discorde et la guerre civile: la Flandre était divisée en patriotes et en partisans de la France, en Clauwaerts et Leliaerts; en Hollande les Hoekschen et Kabeljauwschen, en Frise les
| |
| |
Schieringers et Vetkoopers, en Gueldre les partis de Bronkhorst et de Hekeren se faisaient une guerre à mort; le duc de Brabant n'avait point de postérité; le comte de Flandre, lui-même, ce prince qui témoignait une aversion invincible contre la langue de ses sujets, donna sa fille, son seul enfant légitime, en mariage au duc de Bourgogne, et ouvrit ainsi la porte des Pays-Bas à ce puissant souverain. Tirant babilement parti de la position critique des différentes provinces, les ducs de Bourgogne s'en rendirent maîtres en peu d'années; ils furent même sur le point de fonder un royaume capable de soutenir glorieusement la lutte contre notre ennemi acharné. Mais la domination bourguignonne apporta avec elle un fléau plus redoutable que les bataillons armés de la France; les Bourguignons étaient un peuple français, et leurs ducs des aspirants au trône des Valois.
Déjà la langue avait vu s'altérer sa pureté: en Flandre par le double contact avec le français du côté du royaume de France et du Hainaut, en Hollande par le transport de la couronne souveraine dans la maison d'Avesnes. L'esprit d'imitation s'empara du peuple, et les poëtes surtout se servirent d'un langage hétérogène, signe visible de la décadence qui souillait le front néerlandais. Mais ne précipitons pas les événements.
| |
| |
A l'avénement de la maison de Bourgogne, les Sprekers et les Gezellen avaient pour la plupart oublié leur vie errante et contracté des habitudes plus sédentaires. L'esprit d'association, si vivace dans ces temps, ne pouvait manquer d'agir sur nos poëtes, et les mêmes causes qui portaient les hommes à se réunir pour se former à la guerre, devaient les rallier sous des devises non moins sérieuses dans un but littéraire.
Quelques-uns font remonter l'origine de nos chambres de rhétorique jusque bien avant dans le moyen âge. La ville de Diest prétend qu'elle possédait une société poétique dès 1302, et d'après leur devise aMor VInCIt, les Catharinistes d'Alost dateraient de l'année 1107. Ces assertions sont invraisemblables, bien que des pèlerins, venus de terre sainte, puissent avoir donné dans ces lieux des représentations de quelque mystère, et que la tradition ait fait de quelques hommes se rencontrant par hasard, une société permanente. Peut-être aussi Diest et Alost ont servi pendant quelque temps de résidence à l'un ou à l'autre ménestrier.
Je viens de citer les pèlerins. Quoiqu'il soit inexact de prétendre que le drame nous fut apporté par ceux qui visitèrent la terre sainte, - car c'est des Romains que nous tenons directement le théâtre, qui à aucune époque ne périt tout à fait sur
| |
| |
notre sol, - il est pourtant incontestable que des pèlerins à leur retour en Europe donnèrent des représentations de différentes scènes de la vie de Notre-Seigneur. Dans les églises, ces représentations étaient le complément du service divin aux grands jours de fête, à la Noël, au jour des Trois Rois, à Pâques, à la Pentecôte. Elles étaient données soit par des prêtres, soit par des Gezellen; peut-être encore hommes d'église et laïques s'entr'ai-daient-ils dans la même représentation. On jouait aussi sur les places publiques les jours de procession; ainsi Henri Bal, de Malines, à la demande du magistrat de Lierre, composa et joua avec ses compagnons, de 1432 à 1475, à différentes reprises dans cette ville le jeu de Saint Gomare et autres; ainsi la chambre de rhétorique la Fleur de Blé, de Bruxelles, joua en 1444 la première joie de Marie, le plus ancien mystère flamand qu'on ait pu découvrir jusqu'à ce jour.
A mon avis, les chambres de rhétorique, ou sociétés dramatiques et littéraires, durent leur origine à ces Gezellen, soit que ceux-ci ne se réunissent que momentanément, soit que déjà au quatorzième siècle, à l'instar des arbalétriers et autres corporations de ce genre, ils se fussent constitués en société ou confrérie. Quelques auteurs pensent qu'ils sont un produit immédiat des sociétés d'arbalétriers; je
| |
| |
suis tenté de croire que ceux-ci, très-florissants à cette époque, ont appelé les Gezellen à égayer par des jeux scèniques des fêtes qui duraient quelquefois plusieurs jours.
C'est dans les premières années du règne de la maison de Bourgogne que l'on voit ces sociétés se constituer, prendre un accroissement considérable, établir des concours et recevoir des subsides des villes. En 1394 la ville de Tournai donna un concours littéraire, où les chambres flamandes furent appelées à lutter entre elles. Mais dans le pays wallon ces sortes d'exercices ne se répandirent pas aussi généralement qu'en Flandre, où bientôt il ne se trouva pas de ville, de simple village même qui n'eût sa chambre de rhétorique. De la Flandre l'engouement pour ces réunions passa dans le Brabant. Jean IV, le fondateur de l'Université de Louvain, à l'exemple de son cousin le duc de Bourgogne, encouragea la noble science. Après le Brabant ce furent la Hollande et la Zélande, nouveaux apanages du grand-duc, qui participèrent au mouvement.
La nature des travaux des chambres de rhétorique ne pouvait manquer d'attirer l'attention des Flamands. Nous avons vu dans le chapitre précédent que Maerlant, le grand réformateur de la littérature au treizième siècle, et avec lui, quelques
| |
| |
dignes contemporains et successeurs, avaient dirigé l'esprit public vers la voie didactique. Le peuple il est vrai, toujours poétique par lui-même, n'abandonna pas la littérature pittoresque, comme nous aurons bientôt occasion de le démontrer; mais contraint dans ses goûts par ceux qui avaient le monopole de l'intelligence, sans égard pour leurs devanciers, il se forma sur son nouveau modèle, et la littérature prit une direction déplorable sous le rapport de la forme, de l'expression et de la pensée; elle se fit destructive et ergoteuse. Et cependant cette école parvint à maturité, et il en sortit un peuple qui osa se mesurer avec le plus formidable despote qu'ait subi l'Europe moderne avant le dix-neuvième siècle!
Les chambres de rhétorique se divisaient en deux catégories, les franches et les non-franches. Pour être déclarée franche il fallait deux octrois, un de l'autorité du lieu, qui de ce chef s'engageait à fournir des subsides, l'autre de la chambre supérieure (hoofdkamer), ainsi que s'intitulaient l'Alpha et Omega d'Ypres et la Fontaine de Gand. Par ce dernier on acquérait le droit de se présenter dans les concours.
Les membres d'une chambre étaient divisés en chefs, Hoofden, et en simples membres, Kameristen ou Kamerbroeders. Les chefs s'appelaient Prince,
| |
| |
Empereur, Doyen, Hoofdman, Facteur. Il y avait aussi un Fiscal pour maintenir l'ordre, un Porte-étendard et un Fou.
Le Facteur était le poëte de la société. Son office consistait à composer les poëmes et les pièces de théâtre pour les grandes solennités; à formuler les billets d'invitation, à résoudre les questions proposées par les autres sociétés. Il était tenu d'enseigner l'art de la rhétorique aux jeunes gens, et distribuait les rôles aux acteurs. Chaque facteur avait sa devise, le plus souvent une anagramme de son nom, sous laquelle il était connu par tout le pays. Le véritable chef de la chambre était le prince qui jouissait d'immenses prérogatives; jamais le facteur ne lisait un refrain sans le lui dédier.
Les chambres s'exerçaient à la composition de poëmes de divers genres, qu'à des époques fixes, leurs auteurs récitaient devant toute la compagnie. Mais ce qui surtout était cultivé avec enthousiasme, c'étaient les jeux scèniques qui avaient lieu à des jours solennels, ou lors des concours ouverts par l'une ou l'autre société du pays. Ces concours avaient lieu d'ordinaire pour les chambres franches de la même province. Parmi les grandes réunions du milieu du seizième siècle, nous citerons le Landjuweel de 1539 à Gand pour les chambres de la Flandre, le Landjuweel et le Haegspel de
| |
| |
1561 à Anvers pour les chambres brabançonnes, et le Landjuweel de la même année à Rotterdam pour les chambres hollandaises. On nommait Landjuweel (joyau du pays) le concours entre les sociétés des villes ou plutôt l'entrée triomphale de ces sociétés; on donnait le nom de Haegspel (jeu de haie) à l'entrée solennelle dans un village, ou dans une ville pour la clôture d'un joyau du pays. Dans ce dernier cas il était réservé aux sociétés du plat pays et à celles des villes qui n'avaient pas pris part au Landjuweel.
Rien de plus magnifique que ces fêtes données aux frais des villes et de la noblesse; les étrangers aussi bien que les gens du pays accouraient y unir leurs applaudissements; des milliers de cavaliers, rivalisant de luxe et de richesse, s'y rendaient avec empressement, et des milliers d'amateurs y affluaient portés sur des chars de triomphe, et venant s'y disputer la palme de la science et de l'esprit. La noblesse ne tarda pas à se mêler à ces solennités, d'abord par désoeuvrement, puis afin d'imiter ceux des souverains qui, comme Henri IV de Brabant et Philippe le Bel aimaient les lettres flamandes et le mouvement littéraire national; plus tard enfin pour conférer dans ces solennités sur les plus sérieux intérêts de la chose publique.
| |
[pagina t.o. 76]
[p. t.o. 76] | |
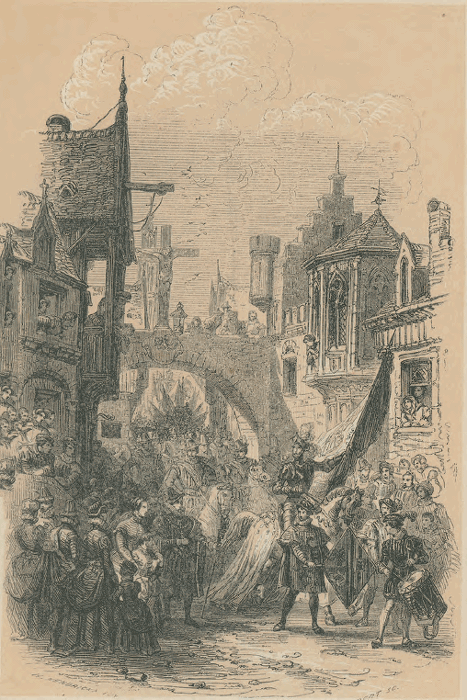
Entrée d'une chambre de Rhétorique, à Anvers.
| |
| |
Nous avons vu quelle était la position relative des différentes chambres d'une province entre elles, et nous avons dit qu'il y avait des hoofdkamers, usant du droit d'octroi à l'égard des autres. Philippe le Beau posant ce fait en principe et voulant donner une impulsion uniforme à toutes les chambres flamandes, érigea en 1493 à Malines une chambre souveraine, à laquelle il donna pour prince souverain son chapelain, Pierre Aelturs. L'arrêté était pris: ‘d'après une convention des différentes chambres, colléges et confréries de l'art de rhétorique en langue thioise, se trouvant dans les Pays-Bas, au moins de la majorité d'elles, convoquées spécialement à cet effet.’ En 1505 Aelturs transporta cette chambre souveraine de Malines à Gand, où il lui procura un autel dans la chapelle même du prince. Elle devait se composer de quinze membres, dont le président ou prince était le souverain lui-même. Mais comme ce dernier ne pouvait pas toujours être présent aux réunions, on élut un stathouder (lieutenant). Il y avait quinze élèves, tenus d'apprendre l'art de la rhétorique, et comme cette institution était en partie religieuse, on y admit quinze dames en l'honneur des quinze joies de Marie. Les assemblées générales avaient lieu quinze fois par an. Une telle distinction provoqua la jalousie des autres chambres de Gand, d'autant plus
| |
| |
que la Fontaine perdit par là son droit d'octroi. Elles en appelèrent au conseil de Flandre et au grand conseil de Malines; mais l'empereur Maximilien, en sa qualité de tuteur de son neveu Charles (V), donna à deux reprises gain de cause à la chambre souveraine. Cette institution ne survécut guère aux princes flamands, et Charles-Quint en fut le dernier chef. Elle salua encore en 1577 le prince d'Orange: c'est le dernier signe de vie qu'elle ait donné.
Le théâtre que la domination bourguignonne nous apporta de la France, était tout allégorique; c'était une représentation froide de vertus et de vices, succédant au drame du moyen âge, faible chaînon qui rattachait la tragédie ancienne à la tragédie nouvelle. Le drame allégorique ou spel van sinne se prêtait bien à la tendance d'esprit à la fois religieuse et satirique des Belges; et plus l'esprit public marchait dans la voie de la discussion, plus il prenait cette allure réactionnaire qui aboutit à la réforme. Dès avant le milieu du seizième siècle, l'esprit de Luther dominait en Flandre, et se manifestait par la voix des rhétoriciens. La majeure partie des pièces allégoriques jouées à Gand au Landjuweel de 1539 sur la question: Quelle est la plus grande consolation pour l'homme mourant? sont des satires sanglantes contre le pape, les
| |
| |
moines, les indulgences, les pélerinages etc. Aussi dès leur apparition, ces pièces, provoquées par Charles-Quint lui-même, furent-elles défendues, et ce n'est pas sans raison que plus tard on citait le Landjuweel de 1539 comme ayant le premier remué le pays littéraire en faveur de la réforme.
Revenons aux faits qui, dans ce siècle d'agitation, se pressent en foule autour de nous.
Les drames destinés aux concours étaut des réponses aux questions données, leur nombre s'accrut considérablement et chaque société eut son répertoire. Ce répertoire est généralement resté inédit, et même la plupart des auteurs des pièces publiées ne sont connus que par leur devise. Parmi ceux qui ont écrit des pièces allégoriques au seizième siècle, on cite Ryssaert van Spiere, d'Audenarde et Guillaume van Haecht, d'Anvers.
On peut indiquer encore comme tombés dans le même oubli les auteurs des esbattements, les satiriques par excellence, les conservateurs de la farce du moyen âge, parfois plus spirituelle, plus mordante, mais tout aussi peu morale. La domination bourguignonne ne porta pas une modification notable à ceux-ci. Les pièces de Corneille Everaert, qui écrivit entre les années 1509 et 1531, pour le théâtre des Drie sanctinnen de Bruges, sont tout
| |
| |
à fait dans le goût de celles que nous avons passées en revue dans le chapitre précédent. Ce sont des fabliaux mis en action: il y règne parfois une licence étonnante, mais tolérée au théâtre: car nos pères semblent avoir eu d'autres idées que nous sur la façon dont la scène agit sur l'auditoire. Ils représentaient le scandale, le vice dans toute leur nudité, et, au siècle dont nous parlons ils les montrent à travers le prisme de la satire et du burlesque; puis à la fin de la pièce arrivait l'application morale. Les modernes, au contraire, exigent qu'on les amuse, et ils ne veulent à aucun prix admettre l'application.
Les pièces d'Everaert, restées inédites (et il faut l'avouer, on a reculé devant la publication), sont au nombre de trente, presque tous esbattements entremêlés de quelques spelen van sinne et de jeux de table (tafelspelen), petites pièces qu'on représentait aux festins des grands et des particuliers; compositions de diverse nature, empreintes souvent de l'opinion politique et religieuse dominante. Parmi le petit nombre d'auteurs d'esbattements connus de nom, je citerai encore J. De Knubber de Bruxelles et Colyn van Ryssel.
La forme du drame, dont nous avons donné plus haut un échantillon, n'était pas exclusivement en vogue: il y avait des pièces qui rappelaient le
| |
| |
drame du moyen âge; tel est le Homulus de Van Diest, poëte brabançon du commencement du seizième siècle. Ce Homulus est une espèce de don Juan; c'est peut-être la pièce la plus hardie que nous ayons de ce siècle; elle justifie encore aujourd'hui l'accueil qu'elle reçut, et qui lui valut l'honneur d'être traduite en latin. Le Saint Trudon, drame inédit du Limbourgeois Fastraets, plein de verve et de hardiesse, tient davantage du mystère.
L'habit historique s'adaptait même très-bien au jeu allégorique, qui s'empara à la fois de la Bible, de l'histoire ancienne et des annales du pays. Parmi les auteurs de ces sortes de pièces, je citerai le prêtre François Machet, dont la Destruction de Sodome, jouée à Courtrai, n'a pas encore été publiée; Keyaert, Houwaert, Duym, et peut-être De Roovere, Manilius et Van Mander, dont jusqu'aujourd'hui je n'ai pu trouver les pièces dramatiques. Ici les sens (zinnekens) ne sont ordinairement qu'au nombre de deux, jouant des rôles satiriques et bouffons, et faisant en quelque sorte l'office des choeurs de la tragédie grecque ou du confident de la tragédie française. C'est ainsi que dans Enée et Didon, de Houwaert, Jonstich van herte et Fame van eere, véritables satires, nous rendent témoins de la flamme dévorante du couple amoureux, tout
| |
| |
en débitant de sanglants sarcasmes sur le faible prince troyen, sur la reine en délire et sur la fidélité des femmes; et comme dans ces temps l'esprit était sans cesse préoccupé de la position critique où se trouvait notre patrie, le poëte ne craint pas de rompre l'unité de la pièce, qui réellement est menée avec art, en faisant des allusions directes aux circonstances du jour.
Si du théâtre on reporte la vue vers cette autre forme poétique tant cultivée par les poëtes rhétoriciens, le refrain (referein), on y voit cette même tendance à l'assimilation à l'esprit du temps, la pensée intime de la nation se gravant dans des couplets comme en des blocs de granit. Ici encore point de noms; car qu'est-ce qu'une vingtaine de noms pour des milliers de poëmes sortis de la tête du peuple, lus et chantés devant des villes entières? Qu'est-ce qu'une centaine de noms dans un pays où des centaines de villes et de bourgs comptaient chacun au moins sa chambre de rhétorique, travaillant tous avec une égale ardeur au progrès d'une idée? Mais le théâtre était exclusivement au pouvoir des chambres, tandis que le refrain, manifestation plus individuelle, n'avait pas besoin du concours de plusieurs pour se faire comprendre. Aussi les pièces de théâtre sont-elles pour la plupart favorables à la Réforme, tandis que le refrain eut aussi de rudes
| |
| |
jouteurs en faveur de Rome: et si en général le refrain catholique ne l'emporte pas sur le refrain réformiste, au moins il lutte avec avantage, et Anna Byns est reconnue par tous comme s'étant dignement placée à la tête des poëtes de la première moitié du seizième siècle, par l'énergie de la diction, la pureté du langage et l'harmonie des vers. Anna Byns, femme d'une dévotion remarquable, était institutrice à Anvers, sa ville natale, où elle mourut vers le milieu du siècle, dans un âge avancé. Elle était l'oracle des catholiques; ceux-ci lui décernèrent le nom de Sapho brabançonne; nom peu convenable, il est vrai, mais parfaitement justifié dans les idées de l'époque; - ils traduisirent ses vers en langue latine et réimprimèrent ses oeuvres pendant un siècle et demi. Certes la réputation d'un auteur n'est pas le gage d'une gloire durable, surtout quand l'esprit de parti a intérêt à la soutenir; mais nous pouvons hardiment l'avancer, - et mon jugement est facile puisque je me trouve devancé par tous nos critiques, - cette réputation n'est nullement usurpée.
Anna Byns brillait de son plus vif éclat sous le gouvernement de Marguerite d'Autriche, c'est-à-dire au temps où la langue nationale s'abâtardit le plus sensiblement. Quoique, au fond, cette princesse ne fût nullement antinationale et que même
| |
| |
elle passe pour avoir fait de jolis vers flamands, elle propagea activement les idées françaises. Élevée à la cour de Louis XI, elle se prit d'un enthousiasme sans bornes pour tout ce qui relevait de la France. Elle attira à sa cour toute la noblesse du pays, qu'elle mit en contact avec une nuée de courtisans français, s'entoura de beaux-esprits français, auxquels elle disputa la palme de la poésie, et aidée par les premiers musiciens de l'Europe et les maîtres de danse les plus renommés, elle fit de son gouvernement une longue suite de fêtes. Au milieu de ce tourbillon de frivoles plaisirs, le peuple et sa langue furent oubliés, la noblesse apprit à communiquer avec lui dans un langage à moitié étranger; et le peuple, toujours enclin à imiter les grands, accueillit ce jargon comme l'expression d'une civilisation plus polie, plus élégante. Bientôt le flamand, qui n'avait déjà plus sa pureté primitive, devint méconnaissable sous la plume des poëtes, et de même qu'à la cour, où tout était frivolité et coquetterie, dans les cercles littéraires le langage du coeur disparut de la poésie pour céder la place à des ornements futiles et sans couleur.
C'est alors que parut Casteleyn, le législateur du Parnasse flamand à cette époque. Ce poëte, doué de plus de patriotisme que de verve, écrivit
| |
| |
un art poétique, nommé par lui, selon les idées du temps, art de rhétorique (Const van Rhetoriken). Il était assez rare alors qu'un poëte publiât ses oeuvres, car on tint note de ceux qui eurent cette hardiesse. Aussi l'ouvrage de Casteleyn, qui était prêtre et facteur de la chambre Pax vobis à Audenarde, ne parut-il qu'après la mort de l'auteur, mais précédé d'une réputation qu'il eut l'avantage de conserver pendant toute l'époque bourguignonne. C'était le vade-mecum des facteurs et des élèves, éloigné des excès de l'école, donnant parfois des préceptes sages, conformes au génie particulier de notre langue. A l'imitation de la France, d'où on nous les importait, les écrivains des Pays-Bas employaient une infinité de sortes de vers, dont les noms barbares le disputaient à la trivialité. On voyait figurer des
Dobbelsteerten, scaecberd, simpletten, dobbletten,
Ricqueracken, baguenauden, cocquerullen,
que notre législateur eut le bon sens de condamner malgré les saltimbanques littéraires. Les genres que Casteleyn prôna le plus, furent la Ballade, le Refrain et la Snede. C'étaient des poëmes divisés en strophes, le premier de sept à neuf, le second de dix à vingt vers, tandis que les strophes du dernier en avaient un nombre indéterminé. Le refrain tenait son nom du dernier vers qui ordinairement revenait
| |
| |
à la fin de chaque strophe, et était réputé plus ou moins parfait selon sa valeur épigrammatique. Il y en avait de trois différentes espèces, du genre sérieux, du genre gai et du genre amoureux (in 't wyse, in 't zotte en in 't amoureuse). Ce dernier servait réellement de passe-temps; mais les deux premiers étaient les grands véhicules des idées du jour. C'est dans le refrain qu'Anna Byns, dans un langage admirable de pureté pour l'époque, lança ses épigrammes énergiques contre Luther et ses adhérents. Humble femme que la foi rendit courageuse et forte, elle mania la langue avec tant de bonheur que ses poésies, toutes vieillies qu'elles soient sous le rapport des formes grammaticales et des régles de la syntaxe, n'ont pas cessé d'émouvoir par l'harmonie du rhythme et par la pureté et l'énergie de la diction. Sous le rapport du courage et de la position, Anna Byns a quelque rapport avec Bilderdyk: tous deux luttèrent avec éclat contre l'esprit de leur siècle. Mais la voix du poëte dans sa retraite, que peut-elle contre la grande voix du peuple? Celle-ci est la voix du destin.
On se passionnait pour la liberté de conscience. Tandis que les placards de Charles-Quint jetaient aux bûchers quelques poëtes et de malheureuses femmes, les livres se répandaient par milliers parmi
| |
| |
le peuple. C'était un grand et beau spectacle que cette agitation des esprits alimentée par l'imprimerie récemment répandue dans toutes les villes de quelque importance, entretenue d'ailleurs par l'inquiétude d'un avenir de plus en plus obscur. Le goût de l'examen nécessita la traduction de la Bible en langue vulgaire; cette tâche fut confiée à l'université de Louvain. C'était une sorte de compensation pour les atteintes réitérées portées au sentiment national par l'introduction de la langue française dans la haute administration.
Cependant la réforme marchait de progrès en progrès: la presse s'empara de la controverse et montra plus de résistance en proportion des entraves qu'on lui suscitait. Ceux qui périssaient victimes de leurs opmions religieuses furent honorés comme martyrs, et on chanta des hymnes en leur honneur. Messire Guillaume van Zuylen van Nyevelt publia un recueil des psaumes de David qu'il fit mettre en musique sur les airs populaires les plus connus. Ces chants formaient une partie essentielle du service divin protestant en remplacement du rite catholique; ils furent accueillis avec un tel enthousiasme par le peuple, nonobstant toutes les persécutions, que dans l'année de leur apparition (1540) ils eurent à Anvers six éditions différentes. Les airs notés furent pour beaucoup dans cette vogue. Par
| |
| |
circonspection, on parodiait des chants généralement connus, et au besoin on les substituait à d'autres compositions poétiques.
Sous le rapport de l'art, l'oeuvre de Van Zuylen est du plus haut intérêt. Dans l'abâtardissement général de la langue au commencement du seizième siècle, le chant populaire resta pour ainsi dire intact à l'abri des souillures des rhétoriciens. Il demeura ce qu'il était dans les siècles précédents: simple et naïf, sous le rapport de la composition poétique et de l'expression musicale. La romance, la ballade, la chanson érotique, le chant religieux même, tout indiquait ce peuple indépendant, vivant de sa vie propre, marchant dans la voie du progrès sans être froissé par des idées contraires à sa nature.
Van Zuylen avait cherché à imiter jusqu'à la simplicité naïve du chant populaire; il eut le mérite de le retirer de l'oubli. Mais d'un autre côté, en chantant le psaume on oublia la chanson primitive, et la mélodie seule resta. Les catholiques imitèrent les réformés: leurs hymnes furent notés sur des airs populaires et le texte de la plupart de nos chants se perdit à jamais.
En réalité le sentiment moral, cette essence de notre caractère, restait toujours fortement empreint dans la nation: et pendant la grande crise du seizième
| |
| |
siècle, comme avant cette époque, le poëme didactique demeura le genre dominant dans la littérature. Les années qui précédèrent l'apparition d'Anna Byns, peu riches en productions littéraires, et pouvant être envisagées comme un temps de repos dans un pénible mouvement social, ces années, formant la dernière moitié du quinzième siècle, comptent comme des hommes de grand mérite, entre autres Jacob Vilt, de Bruges, Lambert Goetman, Gérard Roelants, Thierry de Munster et Jean Van den Dale. Les ouvrages de ces auteurs sont dignes d'éloge par la pureté du langage et l'élégance de la diction: les vers n'annoncent pas encore le contact avec les rhétoriciens. Le plus connu d'entre eux est Jean Van den Dale qui remporta le prix proposé par la chambre de rhétorique de Bruxelles het Boek (le livre). Ce prix consistait en une précieuse bague offerte par Philippe le Bon. Il nous reste de Van den Dale deux poëmes, imprimés après sa mort vers le milieu du seizième siècle: l'un est intitulé de Huere van der doodt (l'heure de la mort), l'autre s'appelle die Stove (la maison de bain). Le sujet de ce dernier poëme est un entretien de deux femmes sur la difficulté de vivre en paix avec les maris et sur les moyens de trouver le repos domestique. La versification en est facile et harmonieuse. Cet écrit contenait
| |
| |
malheureusement des idées peu conformes aux exigences du duc d'Albe: die Stove fut mise à l'index et les oeuvres du poëte lauréat devinrent des raretés littéraires.
Sans nous arrêter à tant d'autres ouvrages, excellents sous le rapport de la morale, mais médiocres au point de vue littéraire, nous sautons jusqu'au gouvernement du duc d'Albe, l'homme dont la prétendue mission était de calmer dans les Pays-Bas l'émotion politique et religieuse.
Ce soldat arrogant et inflexible fut aussi malheureux dans l'exécution de ses desseins, qu'il mit de persévérance à détruire l'esprit national des Belges. Au lieu de la paix il nous apporta la guerre civile, les échafauds; l'exil était une faveur sous le gouvernement de cet homme qui fit tomber dix mille têtes sous le glaive du bourreau. D'un esprit pénétrant, un coup-d'oeil lui suffit pour découvrir où résidait la force morale du peuple, et la guerre contre la langue et les institutions littéraires fut résolue. Le duc commença par écrire en français ses lettres patentes au conseil de Brabant, mais cet essai n'eut aucun résultat. Il sévit le plus sévèrement possible contre les chambres de rhétorique; son intention était de les détruire toutes à la première occasion; on en acquiert la preuve par la conduite qu'il tint envers la chambre de Malines.
| |
| |
Après l'horrible sac de cette ville en 1572, sous le commandement de son fils, le duc d'Albe rendit à la ville ses droits et ses priviléges, mais il resta inflexible quant à la réouverture de la chambre de rhétorique. Le bourgmestre d'Anvers, Antoine Van Stralen, que nous avons vu à la tête du célèbre landjuweel de 1562, fut décapité par ses ordres: grand nombre de rhétoriciens succombèrent à la suite de tortures, un plus grand nombre encore dut se soustraire par la fuite à cette horrible mort. Frankenthal, Cologne, Wezel, Embden en Allemagne, Londres et Norwich en Angleterre étaient remplies de réfugiés flamands, qui s'y érigèrent en communautés, restant fidèles à leur patrie, le coeur rempli de haine contre l'étranger, alors dominateur absolu de leur pays. Ces malheureux cherchaient leur consolation en Dieu; aussi ne tardèrent-ils pas à publier des cantiques et des psaumes à l'usage du service divin.
Le sire Van Zuylen van Nyevelt, nous l'avons vu, avait publié les psaumes de David avec les mélodies empruntées à des chansons populaires. C'était un moyen de faciliter l'accès du chant réformé au peuple. Quelques années plus tard, et lorsque les villes susmentionnées regorgeaient de réfugiés néerlandais, un noble Gantois, Jean Utenhove, regardant ces mélodies comme profanes,
| |
| |
fit une nouvelle traduction des psaumes, dont il publia une partie pendant sa retraite à Embden en 1557 et 1561. Sa traduction complète des psaumes, regardée par les protestants comme la plus ancienne pour leur culte, parut à Londres en 1566, peu de temps après la mort de l'auteur. Bien que recherchée, cette traduction fut bientôt remplacée par celle de Dathenus, publiée en 1566 et réimprimée à Rouen, à Delft, à Norwich et ailleurs. Cette oeuvre, d'une versification facile et d'une diction assez pure, l'emporta même dans l'esprit du peuple hollandais sur toutes les traductions qui lui succédèrent, jusqu'à la fin du siècle dernier, époque où le chant religieux protestant fut tout à fait réorganisé dans les Pays-Bas. Certes il en avait été publié de meilleures: sous le rapport littéraire l'oeuvre de Dathenus ne valait pas, à beaucoup près, celle de Philippe de Marnix, qui eut en outre le mérite d'être traduite sur le texte hébreu, tandis que Dathenus travaillait sur la traduction de Clément Marot. Mais ce dernier consulta la langue parlée plus que ne le fit Marnix; et au concile de Dordrecht, tenu en 1618 et 1619, dans les discussions pour la traduction de la Bible, on adopta quelques formes grammaticales, particulièrement propres à la Westflandre, le pays natal de Dathenus, et à la Hollande. Il est de plus
| |
| |
à remarquer que le peuple protestant conserva, pour ainsi dire, un respect superstitieux pour l'oeuvre du célèbre traducteur, même après que le nouveau chant eut été introduit à la fin du siècle dernier.
En 1565, parut à Gand une autre traduction des psaumes, d'après Marot, par le peintre Luc de Heere, et en 1579 Guillaume Van Haecht publia la sienne pour le service des Luthériens à Anvers. La traduction faite par Marnix parut dans cette dernière ville en 1580. - D'autres chants religieux, à l'usage des sectaires, furent écrits par des Flamands ou Brabançons, entre autres par Jean Fruytiers, maître de requêtes du prince d'Orange, et par Van Mander, le célèbre peintre, qui quitta avec toute sa famille le lieu de sa naissance, le bourg de Meulebeke, pour aller vivre à Amsterdam, après que cette ville eut abandonné le parti du roi.
Par ce court exposé des publications de chants non catholiques, on comprend combien grande dut être l'agitation religieuse en Flandre et en Brabant. A Gand régnaient Dathenus et Hembyse, et pendant cette période célèbre, la capitale de la Flandre érigea une école à l'usage des réformés: les chaires professorales furent presque toutes occupées par des Flamands, et pendant sa courte
| |
| |
existence, elle produisit des élèves distingués, dont la plupart ont brillé plus tard à Leyde et ailleurs.
Dans la liste des auteurs didactiques du seizième siècle, il nous faut ajouter deux noms appartenant à la brillante phalange d'hommes qui, à cette époque, riche en esprits généreux, manièrent simultanément la plume et l'épée. Ce sont Jérôme Van der Voort, d'Anvers et J.B. Houwaert, de Bruxelles. Le premier servit dans l'armée du prince d'Orange, et le suivit dans toutes ses expéditions. Après avoir remporté quantité de prix dans les concours littéraires, il écrivit, pendant sa carrière militaire, un ouvrage en vers sur Les misères de la vie humaine; cet ouvrage se distingue par une étude approfondie du coeur humain, par une saine philosophie et par un style énergique. Houwaert, qui resta catholique, fut aussi un des partisans avoués du Taciturne. Il prit une part active à la défense de Bruxelles, et à la prise de la citadelle d'Anvers, sur les Espagnols. Outre ses pièces dramatiques, dont nous avons déjà eu l'occasion de dire un mot, il composa plusieurs poëmes didactiques, tels que: Le Jardin des Vierges (den Lusthof der Maechden), Le Cours du monde, Instruction politique, etc. Le premier de ces ouvrages est une série de seize livres ou chants sur les dangers auxquels est exposé le beau sexe; il tend
| |
| |
à démontrer qu'il n'y a de véritable amour qu'en Dieu. Une infinité d'exemples, tirés de la fable, de l'histoire et de la Bible, y répandent un agréable mélange de couleurs, animées souvent par un refrain spirituel. Jamais poëme ne fit une telle sensation, et n'eut une pareille vogue. On crut un moment qu'un nouvel Homère s'était montré en Brabant; les jeunes filles de Bruxelles offrirent à l'auteur une couronne de lauriers, et une foule de poëtes des deux sexes firent à l'envi résonner leur lyre en son honneur. Houwaert fut le devancier de Cats, auquel il paraît avoir servi de modèle pour la composition de l'Anneau Nuptial (de Trouwring): il possédait la facilité du poëte zélandais, car il termina son ouvrage en un seul hiver, en pleine guerre et malgré ses devoirs militaires. A part ce rapprochement, une comparaison entre ces deux poëtes serait injuste, bien qu'il soit vrai de dire qu'on a trop déprécié la littérature du seizième siècle, comme si, à tout prendre, le siècle de Hooft, de Vondel et de Cats ne se trouvait pas à l'état embryonnaire dans les productions du siècle précédent.
A cette époque de travail intellectuel, la prose ne fut pas moins cultivée que la poésie, et nous pouvons dire en son honneur qu'elle fut moins profanée par le mélange d'éléments étrangers. Tout
| |
| |
ce qui était alors du domaine de l'intelligence humaine fut traité en langue flamande, et à cette époque, on le sait, les Pays-Bas produisirent les hommes les plus éminents de leur sièele. L'éloquence de la chaire acquit de bonne heure une mâle énergie: preuve évidente d'une égale application à l'étude de la langue et à celle des idées que l'on voulait propager. Le plus célèbre prédicateur flamand du quinzième siècle, dont le nom soit parvenu jusqu'à nous, est Jean Brugman, de Kempen dans le diocèse de Cologne, mort à Nimègue en 1473, après avoir prêché dans plusieurs villes des Pays-Bas septentrionaux. Harphius, qui mourut à Malines en 1478 et Jean Storm, qui s'éteignit vers le même temps à Bruxelles, brillèrent dans cette phalange de prédicateurs ascétiques, à la tête de laquelle nous avons déjà rencontré le bienheureux Van Ruysbroeck, et qui compte encore les Taulerus, les Brinkerink, les Gerardus Magnus ou De Groote, les Thomas à Kempis et tant d'autres personnages célèbres par le don de la parole.
Ce ne serait pas ici le lieu de parler des vices qui signalèrent alors l'éloquence de la chaire en général, aussi bien parmi les ascétiques que parmi les scolastiques; il est cependant digne de remarque que le défaut capital de cette époque, le mélange
| |
| |
absurde de choses saintes et profanes, tout au plus supportable au théâtre, apparaît à un beaucoup moindre degré dans les sermons flamands que dans ceux de France et d'Italie. C'est encore une preuve du bon sens national, alors que le génie naturel n'est pas entraîné par des impulsions étrangères.
Lorsque les idées de Luther se firent jour dans les Pays-Bas, la mission de les combattre n'allait pas au mysticisme tendre et contemplatif; il fallait plus d'énergie, plus d'ardeur de controverse, il fallait toutes les ressources de l'opposition. Le premier lutteur digne de ses succès fut Herenthals, qui commença ses prédications à Ypres en 1519. Après lui vient Corneille Adriaenssens, de si déplorable mémoire, s'il faut ajouter foi aux infamies qui lui sont attribuées sous le nom de Broeder Cornelis. Né à Dordrecht en 1521, il enseigna pendant quelque temps les belles-lettres à Bruges, et s'y fit remarquer dans la chaire par ses déclamations contre Érasme. Il formulait contre ce dernier des accusations d'hérésie, avec cette éloquence burlesque des moines qui séduit la multitude par sa singularité et non par une onction qui lui fait complétement défaut. Adriaenssens publia ses sermons à Anvers en 1556.
Mais le progrès rapide et universel de la réforme
| |
| |
semblait enlever le don de l'éloquence aux prédicateurs catholiques. Ne rencontrant en général que des incrédules ou des fanatiques, ils finirent par n'avoir d'autres armes que de mauvaises plaisanteries ou une controverse défensive. Lorsque enfin les succès du prince de Parme eurent rendu au roi d'Espagne son autorité sur nos provinces, on vit monter en chaire des prédicateurs vraiment dignes de ce nom. Tels furent Jacques Van der Borg, Costerus et surtout Adriani, d'Anvers, dont les sermons furent publiés dans plusieurs éditions.
Dans les jours de désordre, les réformés ne durent pas obtenir des résultats beaucoup plus satisfaisants. Nous ne possédons pas de renseignements sur le talent oratoire de ceux d'entre les curés flamands qui périrent sur le bûcher, accusés d'hérésie; mais il n'est guère probable, que les sermons de Herman et de Dathenus furent autre chose que des imprécations contre le roi, le culte catholique et ses ministres. Le dernier, que nous avons déjà apprécié comme traducteur des psaumes, joua pendant les troubles un rôle trop important, pour ne pas nous arrêter un moment à lui. On n'est pas fixé sur la manière d'écrire son nom, ni sur le lieu de sa naissance. Né à Ypres ou à Poperingue, Pierre Dathenus portait dans sa langue
| |
| |
maternelle le nom de Daets ou Daeten. On prétend qu'il fut moine, selon les uns, dans l'ordre des Carmes, d'après les autres, dans celui de saint François ou de saint Dominique: on ignore même l'année de sa naissance. Avec des antécédents si mystérieux, Dathenus avait une humeur entreprenante, un caractère fougueux, une éloquence populaire, propre à entraîner les masses. Jeune encore, il fut persécuté pour ses opinions. Durant son exil il prêcha successivement à Londres, à Francfort, à Frankenthal et à Heidelberg, et assista à plusieurs synodes et congrès. De retour dans sa patrie, il parcourut les Pays-Bas, se montrant partout d'une activité extraordinaire, entraînant le peuple par ses sermons. On l'accuse d'avoir encouragé les iconoclastes: cela me paraît même assez probable, car il était dans l'intimité du prince palatin, Frédéric III, et fréquentait sa cour lorsque ce prince, par un décret du 3 octobre 1565, peu de mois avant que les églises furent saccagées en Belgique, ordonna et organisa le dépouillement des églises catholiques dans ses états. A Gand, Dathenus se lia d'amitié avec Hembyse, partageant ses opinions et son pouvoir. Il passa en Hollande, où il fut mis en prison pour s'être permis des expressions insultantes à la mémoire du prince d'Orange. Redevenu libre, il passa de nouveau en Allemagne, où il changea son
| |
| |
nom pour celui de Pierre Montanus et se disposa à exercer la médecine. Il se fixa à Staden, près de Brême et définitivement à Elbing, où il mourut en 1590, regretté de ses nouveaux concitoyens qui lui érigèrent un tombeau magnifique, surmonté de sa statue.
Voilà, bien l'existence d'un véritable génie! L'homme du peuple, appelé partout, à l'étranger comme dans sa patrie, aux emplois les plus honorables; persécuté par les uns, chéri des autres; mourant loin du pays natal, entouré de la vénération de ceux qui lui accordaient une généreuse hospitalité. Sa puissante influence sur le peuple, il la dut surtout à son éloquence entraînante; mais son zèle à propager les idées protestantes y fut pour une grande part. L'empressement que l'on mit à le nommer président du synode de Dordrecht, en 1570, indique assez la confiance des savants en ses vastes connaissances.
Quand on parle de Dathenus, le nom de Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde, se présente de soi-même à l'esprit. Un point d'abord nous intéresse: laquelle des deux traductions des psaumes, celle du prédicateur populaire ou celle du savant, sera-t-elle préferée pour le culte public? Mais là ne finissent pas les rapports entre ces deux hommes, dont le génie a puissamment agi sur leur siècle.
| |
| |
Se rapprochant beaucoup au fond pour les opinions politiques dans ces temps de si remarquable divergence, tous deux marchèrent au même but et avec la même ardeur, quoique par des voies différentes. Tandis que Dathenus soulevait le peuple à sa voix et l'arrachait violemment à Rome et à l'Espagne, Marnix par ses écrits atteignait le même résultat. Issu d'une des premières familles du pays, l'âme de la confédération des nobles, l'ami intime et le conseiller de Guillaume d'Orange, renommé pour sa vaste érudition, ce fut par des écrits anonymes qu'il porta le plus rude coup à ses adversaires: sachant mettre de côté toute vanité d'auteur, il comprit que sa voix serait d'autant plus terrible que, selon les circonstances, elle retentirait comme la voix universelle de la noblesse, des savants ou du peuple. Il fut l'auteur mystérieux du chant patriotique Wilhelmus van Nassauwen, du compromis des nobles, du Roomsche Biekorf (la ruche de la sainte église romaine). Ce dernier ouvrage, que Marnix écrivit pendant son exil, parut en 1569. C'est, sous une forme apologétique, une sanglante satire du culte et des institutions catholiques, captivant l'esprit du lecteur et par la pureté et la nouveauté du style et par le piquant de l'exposition.
Marnix donna une nouvelle impulsion à la
| |
| |
littérature: avec lui commença une ère qui présageait la chute subite de la littérature des rhétoriciens et l'apparition du siècle de Hooft et de Vondel. Sa prose laisse dejà loin derrière elle celle de ses devanciers: plus serrée, elle décèle une étude plus philosophique des anciens, auxquels l'écrivain emprunte ce sel qui le rend l'émule d'Erasme. Il l'emporte encore sur la plupart de ses contemporains par une étude toute spéciale de la langue. A la suite des innombrables barbarismes introduits pendant cette époque dans notre langue, il devait s'être établi une licence funeste: Marnix contribua par ses travaux au remaniement de la partie grammaticale et de la syntaxe. Les ouvrages spéciaux n'étaient pas encore nombreux, et les grammaires du jour traitaient presque exclusivement de l'orthographe. Ces traités se bornent à trois: l'Orthographe néerlandaise (Nederlandsche spellinghe), par Joos Lambrecht, parut à Gand en 1550; l'Orthographia linguae belgicae, par Ant. Tsestich ou Sexagius, à Louvain en 1576, et l'Orthographie néerlandaise (Nederduitsche orthographie), par Pontus de Heuiter, à Anvers en 1581. Mais déjà à la fin du siècle précédent, les frères de la vie commune avaient publié des préceptes grammaticaux en regard de leurs grammaires latines; et c'est probablement à ces hommes, aussi recommandables par leur sentiment national que
| |
| |
par leur piété, que nous devons ces dictionnaires latin-flamand, parmi lesquels le plus anciennement imprimé remonte à l'année 1477. A une époque postérieure, nous voyons Servilius en 1550 et Adrien Junius en 1577, faciliter par leurs dictionnaires l'étude des auteurs classiques de Rome, objets de l'admiration exclusive des Belges. Mais dans ces lexiques, la langue même n'était pas expliquée: cette tâche essentielle fut d'abord entreprise pour un seul dialecte, celui de Clèves, par G. Van der Schueren, qui imprima son Teutonista of Duytschlender à Cologne à la fin du quinzième siècle; puis dans un sens plus général par Christoffe Plantyn et par Kilian. Ce dernier surtout ouvrit une mine féconde aux philologues néerlandais, et son dictionnaire étymologique est resté la principale source à consulter pour l'étude historique de la langue. Vers la fin du seizième siècle, la société de rhétorique d'Amsterdam: In liefde bloeijende, se mit rapidement à la tête de toutes les sociétés des Pays-Bas et de la littérature nationale, par les travaux de quelques-uns de ses membres, publiés sous le nom de cette association. Elle débuta par une grammaire, où le système d'orthographie préconisé n'est point le résultat d'un seul dialecte, comme chez Lambrecht et Tsestich; mais Spiegel, l'auteur présumé, avait également consulté des
| |
| |
philologues hollandais, brabançons et flamands. Cette chambre publia encore un cours de logique (Ruygh-bewerp van de Redekaveling), et un cours de rhétorique (Rederijck-kunst). Érigée depuis peu, elle possédait alors les trois hommes les plus marquants parmi les Hollandais en littérature nationale: Spiegel, Roemer Visscher et Coornhert. Ce dernier se voua plus spécialement à la prose élégante, et devint l'émule de Marnix. Ses traductions de Cicéron et de Boëce se recommandent par la fidélité et la pureté du style, éloge trop rarement mérité par les traducteurs de la première moitié du quinzième siècle. Mais plus les études linguistiques firent de progrès, plus on traduisit correctement et avec élégance. En général alors la prose l'emportait sur la poésie. Pour s'en convaincre il suffit de comparer l'Odyssée par Coornhert, l'Iliade et les Géorgiques par Van Mander, l'Enéide et les Comédies de Térence par Van Ghistele avec les traductions en prose soit des poëtes, soit des prosateurs classiques.
Dans ces temps si orageux de discussions politiques et religieuses, le peuple se sentit dévoré d'un nouveau besoin poétique. A côté de ses cantiques il exhala ses plaintes amoureuses; et les aventures de chevaliers, chantées naguère sur la lyre
| |
| |
des derniers ménestrels devenus des lansquenets, coururent de hameau en hameau. Les épopées des siècles des croisades ayant cessé de répondre, dans leurs formes primitives, aux besoins du peuple, furent traduites en prose, sans perdre tout à fait leur parfum poétique. Ces romans occupèrent la première place dans la bibliothèque bleue, recherchée encore de nos jours dans tous les pays germaniques. Dans ces vieilles éditions, le lecteur se sent parfois blessé par une cadence rhythmique et même par des rimes, tristes débris des anciennes formes épiques; mais ces défauts, qui dans ce siècle de transition n'étaient pas regardés comme tels, sont largement compensés par une naïveté de style qui donne au récit un charme merveilleux pour quiconque a secoué d'injustes préjugés. Parmi les romans de ce temps, je citerai Mariken de Nimègue, imprimé à Anvers en 1514, et écrit moitié en vers, moitié en prose. C'est l'histoire curieuse d'un Faust féminin, non moins intéressant que celui dont s'occupe, depuis trois siècles le monde lettré.
A côté des romans viennent se ranger les voyages, qui à cette époque se firent encore dans les pays d'Orient. Les plus remarquables sont ceux de Joos Van Ghistel, noble gantois, qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme et contemporain
| |
| |
Corneille, que nous avons rencontré parmi les traducteurs des poëtes classiques de Rome.
Au point de vue littéraire, les historiens de cette époque, dignes d'être mentionnés, sont peu nombreux. Les plus célèbres appartiennent à la Flandre. Nicolas Despars, de Bruges, écrivit une Chronique de ce pays dans un style pittoresque et agréable, mais ayant à un haut degré le défaut de la première moitié du seizième siècle à laquelle il appartient, c'est-à-dire hérissé de termes bâtards. Cette chronique, écrite dans un sens tout national et dont les défauts sont dus à l'éducation partiale de l'auteur, est un fidèle reflet du langage en vogue alors parmi la noblesse néerlandaise. On cite encore un autre historien, Marc van Vaernewyck, né à Gand, où il mourut dans un âge avancé, auteur entre autres ouvrages d'une Histoire de la Belgique (Historie van Belgis), attestant une grande érudition et beaucoup de recherches, mais rédigée avec trop peu d'ordre. Cet ouvrage est d'ailleurs curieux pour la partie traditionnelle, ce qui pour certaines parties le fait rentrer dans le cadre des romans.
Avant de clore cette époque, constatons qu'au seizième siècle surtout, le peuple flamand, qui se plaît à mêler aux choses positives l'amour du mystérieux, se vouait tout particulièrement aux seiences naturelles, surtout à la botanique. Vers l'année 1543,
| |
| |
le célèbre professeur allemand Fuchs fit paraître à Bâle son Nouvel Herbier (den Nieuwen Herbarius), le plus ancien monument de ce genre connu dans notre littérature; il le dédia à Marie de Hongrie, la soeur de Charles-Quint. Dix ans plus tard, Dodoné, de Malines, publia sur le même sujet son grand ouvrage qui acquit une popularité immense dans le pays, et qui fut traduit en plusieurs langues par les plus estimables savants.
|
|