Histoire de la littérature flamande
(1849)–F.A. Snellaert–
[pagina I]
| |
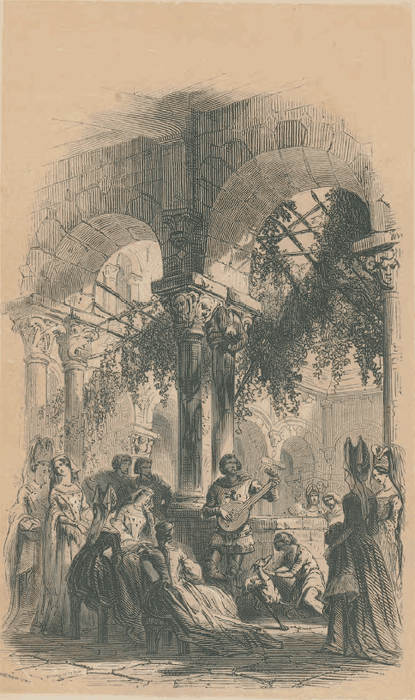 Jean Ier chantant aux dames de sa cour des chansons composées par lui.
| |
[pagina 5]
| |
Histoire abrégée de la littérature flamande.L'idiome germanique se divise en deux branches principales, aussi distinctes l'une de l'autre par la forme et par l'accent que les contrées où on les parle ont un aspect différent, et que, sous le rapport du goût, les peuples germains de l'est ressemblent peu à ceux de l'ouest. On pourrait les nommer, l'une aux inflexions plus molles, la langue maritime; l'autre à l'accentuation plus rude, la langue montagnarde. A la première de ces deux langues, outre les dialectes scandinaves qui, de bonne heure, constituèrent un groupe à part, appartiennent l'anglo-saxon, le saxon et le frison. L'anglo-saxon forma | |
[pagina 6]
| |
insensiblement la langue moderne des Anglais. Moins cultivé dans le nord de l'Allemagne et mêlé au haut allemand, le saxon dégénéra bientôt en Platduitsch, tandis que dans les Pays-Bas il resta l'élément principal de la langue du pays, du flamand ou Nederduitsch. Aux premiers siècles de l'ère chrétienne, nous trouvons dans l'ouest et dans le nord des Pays-Bas des habitants de souche saxonne ou frisonne. Au nord-est se montraient les Francs, bas allemands comme les précédents, mais qui, dans un but politique, s'assimilèrent la langue d'alliés haut allemands, tout en imposant leur propre nom à ce dialecte étranger. Ces trois peuples, les Saxons, les Frisons et les Francs, ayant apporté chacun leur contingent dans la formation de la nation flamande ou néerlandaiseGa naar voetnoot1, leurs langues respectives ne tardèrent pas à coopérer au développement de notre idiome. La différence entre le frison et le saxon était trop peu essentielle pour que, sous certaines conditions, la fusion ne s'opérât pas facilement. Nous voyons le premier reculer continuellement pour céder la place à son frère, moins éloigné que lui du franc, le dialecte de leur vainqueur | |
[pagina 7]
| |
commun, qui vint jeter sur leur propre territoire les bases d'une domination étendue. Au moment de sa chute, l'empire romain fut assailli de tous côtés par des peuples germains. Goths, Bourguignons, Alemans, Francs et autres l'attaquèrent par le continent; les Saxons, les Frisons, les Normands, par mer; et lorsque l'heure fatale eut enfin sonné pour les tyrans du monde, ceux qui s'étaient emparés de leurs dépouilles se ruèrent les uns sur les autres. Les Francs, aspirant à la domination universelle, restèrent partout les maîtres, et sous le sceptre de Charlemagne s'éleva un nouvel empire d'Occident, beaucoup plus étendu que celui sur lequel avait plané l'aigle des Césars. Ces peuples embrassèrent la religion chrétienne à des époques différentes et sous des influences très-diverses. Les conquérants, et en première ligne les Goths, se rallièrent de bonne heure à la civilisation nouvelle, tandis que ce fut sous Charlemagne seulement, que les Saxons et les Frisons se laissèrent imposer un autre culte que celui de leurs pères; longtemps même après la mort de ce monarque, le christianisme n'avait en Flandre qu'une existence fort précaire. Il ne nous est parvenu aucun monument littéraire de ces temps de paganisme, et sans les livres scandinaves de théogonie, | |
[pagina 8]
| |
sans l'Edda, nous serions fort peu avancés dans la connaissance des dogmes religieux de nos ancêtres. Ce qui nous reste de documents dans les dialectes antérieurs à Charlemagne ou de l'époque même de ce grand homme, a été composé presque exclusivement pour favoriser la propagation du christianisme. Au cinquième siècle, Ulfilas, évêque chez les Mésogoths, traduisit la Bible; il nous en est parvenu quelques fragments qui nous montrent le gothique comme un dialecte mixte entre le haut et le bas allemand. Du septième au huitième siècle on a recueilli une traduction franque de l'ouvrage sur la Nativité du Christ, de l'évêque espagnol Isidore, ainsi qu'une traduction des règles de Saint Benoît en alemanique, dialecte haut allemand, plus dur encore que le franc. Aucun de ces ouvrages n'est écrit dans un idiome qu'on puisse dire avoir été parlé par le peuple des Pays-Bas, quoiqu'il soit vrai que le gothique possède beaucoup de formes essentiellement propres au flamand. Mais l'histoire et les monuments littéraires nous révèlent un dialecte, dont les traces, après dix siècles, sont restées empreintes dans deux langues, parlées par des peuples éloignés l'un de l'autre, et qui démontre que dans les temps antérieurs les îles Britanniques et les Pays-Bas étaient unis par des liens plus étroits que ceux du commerce. En effet, nos ancêtres | |
[pagina 9]
| |
païens reçurent leurs missionnaires des Anglo-Saxons, soit que ces hommes pieux sortissent de la nation même, soit que ce fussent des Gaulois ou autres, qui allaient d'abord en Angleterre apprendre la langue dont ils devaient ensuite se servir dans nos contrées. Cette particularité, et l'empressement que mirent les princes francs à attirer les missionnaires anglo-saxons, sont des indices suffisants que les habitants de tout le littoral inférieur de la mer du Nord: Saxons, Frisons et Anglo-Saxons, participaient à une vie domestique commune, et que les prédicateurs d'outre-mer voyaient dans nos ancêtres des membres d'une même famille, éloignés d'eux seulement par d'antiques croyances nationales. Lors de la domination franque, ces relations diminuèrent sous l'influence de la civilisation semi-romaine du peuple dominateur, et de la protection qu'il offrait constamment contre les incursions des peuples du Nord; car ces derniers, peut-être pour punir ceux qu'ils appelaient des renégats aux anciennes croyances, fondirent à leur tour sur notre pays. Il dut alors s'opérer un changement notable tant dans la langue que dans l'existence morale du peuple: on s'aliéna des hommes restés membres deila famille par la langue et les moeurs, l'idiome prit de plus en plus des allures particulières au franc, et par celui-ci se rapprocha des formes latines. C'est | |
[pagina 10]
| |
probablement de ces temps que date l'introduction de l'alphabet romain, source de tant de confusion dans les langues germaniques. Le plus ancien monument littéraire que notre langue soit en droit de revendiquer, est un fragment d'une traduction en prose des psaumes, appartenant au siècle de Charlemagne. Malheureusement l'éditeur, le professeur allemand Von der Hagen, n'a eu à sa disposition qu'une copie dépourvue d'autorité, reproche légitime qu'au même titre on doit adresser à l'acte de serment de fidélité fait par les Saxons au vainqueur de Witikind. Le chant de Hildebrant et le poëme le Heliand (Heiland, le Sauveur) ont une tout autre valeur. Le premier appartient probablement à un de ces vieux chants sortis de la Germanie païenne, que Charlemagne fit recueillir pour les transmettre aux générations futures, mais qui auront aussi subi quelque altération en passant par une plume franque. Le Heliand est un fragment d'une traduction en vers de la Bible, par un anonyme qui vécut au neuvième siècle: on doit l'admettre comme refléchissant la forme normale de la langue et de la prosodie des peuples bas allemands dans ces temps reculés. Cet anonyme avait pour contemporain le poëte haut allemand Otfried qui, lui aussi, composa un poëme sur le Christ, | |
[pagina 11]
| |
dans lequel semble percer un caractère chrétien plus prononcé. Le poëme d'Otfried est en vers rimés; le Heliand, au contraire, a conservé l'ancienne forme germanique: l'allitération. L'un a les allures de l'épopée, l'autre celles du poëme lyrique; distinction remarquable qui se fait sentir encore aujourd'hui dans les productions poétiques des deux grandes divisions de la Germanie. Le nord de l'Allemagne et les Pays-Bas ont de tout temps manifesté une prédilection pour le genre épico-didactique, tandis que les poëtes de l'Allemagne méridionale s'adonnent avec amour au genre lyrique. La lutte entre le christianisme et le paganisme germanique se prolongea dans nos contrées jusqu'au onzième siècle, alors qu'un nouveau mouvement social vint changer la face de l'Occident. Les croisades établirent des rapports intimes entre tous les peuples chrétiens, et à ce contact les langues se modifièrent dans leur forme: celles de la Germanie reculèrent devant les idiomes nationaux là où elles s'étaient glissées entre les langues romanes; et le français commença la lutte avec le latin pour devenir le lien conventionnel entre les hommes de race différente. C'est dans ce siècle que la langue flamande sortit de son état embryonnaire, pour arriver bientôt à un développement prodigieux, preuve irrécusable du haut degré de bien-être et de civilisation | |
[pagina 12]
| |
dont jouissaient à cette époque les peuples des Pays-Bas. En comparant le Heliand au poëme du Reinaert de Vos, dont la première partie fut composée en l'année 1177, et qui par conséquent est postérieur de trois siècles au premier, on s'aperçoit que, dans cet intervalle, il s'est opéré une modification notable, une véritable révolution dans la langue, et que cette révolution doit être antérieure à la composition de ce poëme. Pour bien comprendre le développement de notre civilisation thioise, constatons un fait politique. Par le traité de Verdun, qui fut conclu l'an 843, entre les trois fils de Charlemagne, les Pays-Bas furent divisés en trois parties. Les contrées situées sur la rive droite du Rhin, Clèves, la Gueldre et tout le nord des Pays-Bas avec les pays frisons, échurent à Louis le Germanique; le pays entre le Rhin et la Meuse tomba en partage à Lothaire et forma la partie septentrionale du royaume de Lotharingie; tout ce qui restait à l'occident, de l'Escaut à la mer, fit partie des domaines de Charles. Il est en outre digne de remarque qu'à l'époque de la triple division de l'empire de Charlemagne (814-847), excepté pour la Flandre, Utrecht et la Frise, les noms de ceux qui gouvernaient les différentes parties de notre pays ne sont pas connus: si l'on considère que la ville | |
[pagina 13]
| |
épiscopale, berceau des études monastiques, ne pouvait être favorable à la culture de la poésie pittoresque, et que les Frisons continuèrent longtemps encore à se servir exclusivement de leur propre dialecte, dans quelle contrée autre que la Flandre, peut-on légitimement supposer que les poëmes de chevalerie auraient pris naissance? Indubitablement c'est sur les bords de la Lys, c'est au milieu des dunes de la mer du Nord, entre Bruges et Dunkerque, que jaillirent les premières étincelles d'une civilisation nouvelle, se manifestant d'abord par les chants des troubadours provençaux et des trouvères du nord de la France. La position politique de la Flandre, fief de la couronne de Neustrie, l'emploi, dans nos monuments littéraires du douzième siècle, d'un dialecte de plus en plus reconnu pour être celui de la Westflandre, sont d'une haute importance dans ce système. Non qu'il faille entendre qu'avant ces temps les peuples des Pays-Bas fussent privés de productions littéraires: nous venons de voir qu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne, tout le littoral inférieur de la mer du Nord se servait d'une langue commune, riche en productions du génie, dont nous admirons encore les débris dans le Beowulf et autres. Il en était de même du poëme héroïque qui florissait aux bords de la Meuse et du Rhin, où les rapsodes chantaient Siegfried, le roi des Pays-Bas, longtemps | |
[pagina 14]
| |
avant que le poëme des Nibelungen eût acquis la forme sous laquelle ce beau monument du génie poétique de nos pères nous est connu. Mais au onzième siècle notre langue, préparée de longue main par le contact intime de trois dialectes différents, prit une forme plus solide; l'expression acquit une clarté et une précision qu'aucun des trois dialectes n'avait connues séparément; la sévérité de la grammaire latine s'introduisit dans l'idiome national, qui insensiblement devint apte à exprimer les choses relevant directement des idées romaines. Dans les premières années du treizième siècle on commença à dresser des actes publics en langue nationale. L'histoire de notre langue et de notre littérature se divise essentiellement en six époques, qui se rattachent à autant de phases diverses dans la vie politique du peuple flamand. A la première époque appartient la littérature pittoresque, le poëme épique germain sous ses différentes formes. Son origine se perd dans l'histoire; elle expire là où la poésie didactique, dans les mains de Maerlant, la tue par le ridicule, c'est-à-dire vers la fin du treizième siècle. La seconde époque donne le pas au poëme historique sur le poëme épique ou héroïque, et fait éclore des écrits exclusivement destinés à étendre le domaine de l'intelligence humaine. | |
[pagina 15]
| |
La troisième époque, qui correspond à la domination bourguignonne, embrasse la littérature des rhétoriciens, caractérisée par des entraves de tout genre dans la forme, et par un génie antinational qui réagit sur la langue même. Elle commence vers le milieu du quinzième siècle et finit avec le seizième. La quatrième époque, qu'on pourrait nommer l'époque de la renaissance, embrasse les beaux jours de la lutte contre l'Espagne. La cinquième époque, l'époque du sommeil, se traîne jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. La sixième époque, celle de la seconde renaissance, commence avec la tourmente révolutionnaire qui travailla la Hollande et la Belgique vers la fin du siècle dernier. Toutefois ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que dans le midi cette renaissance donne des résultats satisfaisants. |
|

